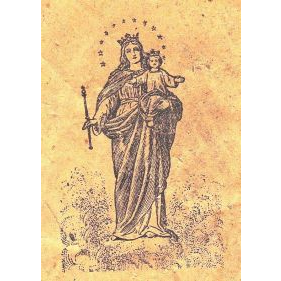 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES
La beauté et la grandeur du récit de la création ont frappé tous les esprits. Il était impossible d’en tracer un tableau plus grand et plus digne. Les savants ne l’ont pas moins admiré que les philosophes. « Ou Moïse avait dans les sciences une instruction aussi profonde que celle de notre siècle, a dit Ampère, ou il était inspiré. » La supériorité du récit biblique est surtout frappante quand on le compare aux cosmogonies des autres peuples, lesquelles sont pleines de rêveries. Quant à la beauté littéraire du premier chapitre de la Genèse, il n’est personne qui n’en soit frappé. Tout le monde connait la réflexion du païen Longin : « Le législateur des Juifs, qui n’était pas un homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur et la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité, au commencement de ses lois, par ces paroles : Dieu dit : Que la lumière se fasse, et la lumière se fit ; que la terre se fasse, et la terre fut faite. »
L’organisation du monde est partagée par Moïse en six actes qu’il appelle jours et qui se distinguent les uns des autres par un soir et un matin. Le premier acte distinct de l’organisation de l’univers est la création de la lumière ; le second fut la séparation des eaux inférieures et des eaux supérieures, c’est-à-dire la condensation d’une partie des vapeurs ou eaux proprement dites, nommées eaux inférieures, lesquelles se séparèrent de celles qui restèrent à l’état de vapeurs ou eaux supérieures ; le troisième, c’est la production des plantes ; le quatrième, la création ou la manifestation des astres ; le cinquième, la création des reptiles et des oiseaux ; le sixième, celle des mammifères et de l’homme. Depuis ce dernier acte, la Providence n’a pas introduit de nouvelles espèces de créatures sur la scène du monde, ce que la Genèse indique en disant que le septième jour Dieu se reposa, c’est-à-dire cessa d’agir.
Ce mot de repos appliqué à Dieu est certainement métaphorique, tout le monde en convient. Il est à croire que le mot « jour, » yôm, « soir, » est également métaphorique. Yôm désigne ordinairement l’espace compris entre deux levers de soleil ; cependant plusieurs raisons, qui ne sont pas sans importance, semblent indiquer que ce terme ne doit pas être pris ici dans le sens propre, mais dans un sens figuré. À une époque où tout s’exprimait en images, l’emploi de métaphores dans la Genèse ne doit pas surprendre celui qui connait les habitudes du langage oriental.
Le mot yôm, jour, signifie très probablement ici époque ou période. Dieu n’a certainement pas mis vingt-quatre heures à créer la lumière, ni vingt-quatre heures à créer les astres, les plantes ou les animaux ; il lui a suffi, pour que tous ces êtres fussent produits, d’un acte instantané de sa volonté. Puisque Dieu n’a pu employer une journée entière à donner l’existence à chacune des espèces de créatures qui ont apparu pendant les jours génésiaques, il y a tout lieu de penser que le mot jour est ici une expression figurée désignant une de ces périodes d’une longueur indéterminée que nous fait connaitre la géologie.
L’étude géologique de notre globe montre qu’il se compose de couches superposées, distinguées les unes des autres par des éléments qui leur sont propres, et en particulier par des fossiles différents. Ces couches se sont formées successivement pendant une longue suite de siècles. On peut partager l’œuvre de la création en trois périodes principales : la période astronomique ou cosmique, la période cosmogéogénique, et la période géologique pure.
I. La période cosmique embrasse la cosmogonie en général ou création des éléments de la matière ; elle comprend le long espace de siècles résumé dans les cinq premiers versets de la Genèse, et correspond au temps qui a précédé le premier jour mosaïque ainsi qu’à ce premier jour lui-même. La science ne connait rien de cette période que par induction.
D’après le système communément admis par les savants, l’éther, principe de la matière, ou des « cieux et de la terre, » a été créé tout d’abord. L’analyse spectrale et les belles découvertes du P. Secchi, d’Huggins, de Miller, etc., démontrent que la composition chimique des corps célestes et terrestres est foncièrement la même. Au commencement, les ténèbres sont complètes. Des centres d’attraction se produisent ensuite sur divers points de l’espace et deviennent le germe des nébuleuses cosmiques et le principe du mouvement.
Le mouvement de concentration et de rotation des nébuleuses amène les premiers dégagements de chaleur. L’élévation croissante de la température produit de la lumière ; les nébuleuses, en se condensant, jettent autour d’elles des lueurs phosphorescentes ; elles se fractionnent, et leurs fragments deviennent des étoiles qui finissent par être incandescentes. La terre est une de ces étoiles. Moïse dépeint l’état primitif de la terre à cette époque, en disant : Terra erat inánis et vácua, « sans ordre, » et il caractérise la période pendant laquelle s’accomplissent les phénomènes dont nous venons de parler, quand, en les considérant par rapport à notre globe, il dit que, le premier jour, Dieu créa la lumière et la sépara des ténèbres.
II. L’époque cosmogéogénique, pendant laquelle la terre s’organise et se couvre de plantes, répond aux second, troisième et quatrième jours de Moïse, Gen., 1,6-19.
1° C’est pendant cette époque que se forment la croute solide de la sphère embrasée et l’atmosphère. Le globe terrestre passe de l’état gazeux à l’état de liquide incandescent ; sa surface commence ensuite à se durcir par le refroidissement. Une atmosphère ténébreuse, sursaturée de vapeurs métalliques et aqueuses, se forme autour de la terre. L’atmosphère devient ainsi distincte du sphéroïde terrestre. C’est la séparation des eaux inférieures et supérieures par le firmament, dont parle la Genèse, c’est-à-dire le second jour mosaïque. Cette période de formation de l’univers est appelée par les géologues âge primaire ou azoïque, parce qu’elle n’offre pas de traces de vie.
2° Le troisième et le quatrième jours génésiaques correspondent à ce que les géologues appellent âge paléozoïque ou de transition. Cet âge est ainsi nommé, parce que c’est celui où l’on retrouve les traces les plus anciennes de vie, des débris d’une flore et d’une faune sous-marine, des cryptogames, des algues et des invertébrés, crustacés et mollusques, oursins et coraux.
Au commencement de cette période, la croute solide est partout recouverte par les eaux précipitées. Les premières iles émergent par suite de la contraction de l’enveloppe terrestre. L’atmosphère, grossièrement épurée, ne laisse parvenir au sol qu’une clarté diffuse ; mais cette clarté est suffisante pour les premiers développements de la végétation terrestre. Aucune autre époque n’a laissé de traces d’une végétation comparable à celle-là. C’est alors que se produit la flore carbonifère et houillère.
Pendant cette période, il n’y avait encore, comme nous le dit Moïse, aucun mammifère, ni aucun oiseau. Il y avait cependant déjà, mais en petit nombre, quelques amphibies rampants, des poissons et quelques animaux inférieurs, dans les bas-fonds marécageux, où ils étaient couverts par une épaisse végétation. La flore houillère se composait de plantes colossales, mais sans vives couleurs ; elles avaient surtout besoin d’ombre et d’humidité. Ce caractère de la végétation houillère fournit la réponse à une des objections sur lesquelles on a le plus insisté contre le récit de Moïse, et en devient même une sorte de confirmation. Comment, a-t-on dit, ces plantes ont-elles pu se développer sans l’action des rayons solaires ? Un savant allemand, M. Pfaff, a répondu avec beaucoup de précision et de justesse : « Ce n’est pas du soleil que les plantes ont besoin, mais seulement de lumière et de chaleur. Or, la lumière et la chaleur existaient incontestablement avant le soleil : c’est là un fait certain en histoire naturelle. »
Quelques batraciens, des animaux amphibies et des poissons commencent alors à paraitre, mais ils sont rares, surtout relativement au grand épanouissement de vie que nous rencontrerons bientôt. Moïse a donc pu n’en pas tenir compte et les passer sous silence ; il ne mentionne, dans chaque époque, que la classe d’êtres qui la caractérise.
Le quatrième jour mosaïque est celui où Dieu complète l’organisation de notre système solaire par rapport à la terre. Quelques exégètes pensent que le soleil existait déjà dans les âges précédents comme corps lumineux, mais que ses rayons n’arrivaient pas jusqu’à la terre. Rien dans la science ne s’oppose à ce qu’on accepte purement et simplement le récit de la Genèse : « Notre soleil estime véritable étoile fixe, dit M. Pfaff. Par conséquent, sa manifestation comme astre distinct peut coïncider avec celles des autres étoiles fixes. L’astronomie n’a rien à opposer à cette affirmation… Il ne saurait donc être question sur ce point d’une contradiction entre l’astronomie et la Bible. » M. Faye pense que la terre a été réellement créée avant le soleil.
Cette époque, qui est la moins ancienne de l’âge paléozoïque, est caractérisée par un ralentissement très sensible de la création végétale. Une nouvelle flore apparut plus tard dans l’âge tertiaire et fut le résultat de l’influence nouvelle du soleil ; mais Moïse, qui avait indiqué le premier grand épanouissement de vie végétale, n’est pas revenu sur les flores successives : il s’est partout contenté d’indiquer les traits les plus saillants de chaque période.
III. L’ère géologique comprend trois âges : l’âge mésozoïque ou secondaire, l’âge cénozoïque ou tertiaire, et l’âge quaternaire, celui dans lequel nous vivons. L’âge mésozoïque correspond au cinquième jour génésiaque ; les âges tertiaire et quaternaire correspondent au sixième jour.
1° Le cinquième jour, nous dit la Genèse, Dieu créa d’abord les reptiles et les volatiles, puis les grands cétacés. L’inspection des couches géologiques confirme ces données.
L’âge mésozoïque ou secondaire comprend trois étages de terrains : l’étage triasique, l’étage jurassique et l’étage crétacé. Il est caractérisé par une abondance prodigieuse de vie animale. La végétation houillère de l’âge paléozoïque avait absorbé une quantité énorme d’acide carbonique et l’avait changé en combustible. Elle avait ainsi purifié l’atmosphère et rendu la terre propre à la vie animale.
Pendant que les coraux et les infusoires formaient le terrain jurassique, les ammonites et les bélemnites vivaient au fond des mers ; les tortues et les lézards se promenaient sur les bords des rivières et des océans ; d’immenses reptiles, armés d’effroyables moyens de destruction, étaient les rois des animaux. Cette époque, à laquelle Moïse rapporte la création des reptiles, est tellement caractérisée par cette classe d’êtres vivants que les géologues l’ont appelée « ère des reptiles. »
La première apparition des oiseaux correspond à l’époque de ces grands sauriens, conformément à ce que nous apprend Moïse. Les terrains jurassiques et crétacés présentent des empreintes de grands échassiers et de grands oiseaux dans le genre de l’autruche. Mais jusqu’ici, comme pour confirmer le récit de la Genèse, on n’a rencontré dans ces terrains nul mammifère, à part un très petit rongeur insectivore, et plus tard, dans la craie, une espèce de sarigue. Les mammifères n’apparaissent qu’à une époque postérieure ; c’est au début de l’âge tertiaire que commence véritablement leur règne : ils sont l’œuvre du sixième jour.
2° Moïse nous apprend, en effet, que ce fut le sixième jour que Dieu créa les mammifères, les animaux d’abord et l’homme ensuite. Cette dernière création correspond à l’âge cénozoïque ou tertiaire et à l’âge quaternaire. La plupart des géologues ne placent des fossiles humains que dans le terrain quaternaire. Ce n’est qu’alors qu’on trouve des traces certaines de sa présence. Conformément à la Genèse, l’homme parait le dernier sur le théâtre de la création. C’est là la dernière confirmation que la géologie apporte au récit biblique. Ainsi la science, dans ses grandes lignes, est d’accord avec la cosmogonie de Moïse. Qui n’admirerait cette frappante harmonie ? « Si nous comparons les données scientifiques avec l’histoire biblique de la création, dit M. Pfaff, nous voyons que cette dernière concorde avec ces données autant qu’on est en droit de l’attendre. Nous découvrons en effet [dans la science et dans la Bible] les mêmes règnes, également distincts en eux-mêmes, en ne tenant pas compte des variations historiques qu’ils ont pu subir ; la suite chronologique de leur apparition est exactement donnée par Moïse. Le chaos primitif ; la terre couverte d’abord par les eaux, émergeant ensuite ; la formation du règne inorganique suivi du règne végétal, puis du règne animal qui a pour premiers représentants les animaux vivant dans l’eau, et, après eux, les animaux terrestres ; l’homme apparaissant enfin le dernier de tous : telle est bien la véritable succession des êtres, telles sont bien les diverses périodes de l’histoire de la création, périodes désignées sous le nom de jours. »
Les savants placent la production de la matière à une époque très reculée. La Genèse ne nous fournit aucune donnée précise sur ce commencement dans lequel elle place la création proprement dite de la matière. La Sainte Écriture ne nous dit nulle part que l’univers a été créé en telle année ou à telle époque. Il est vrai que l’on trouve, dans les livres d’histoire, des dates qui se rapportent à « l’ère de la création du monde, » mais cette dénomination manque de justesse, comme il est facile de s’en convaincre en considérant par quels procédés ont été formées les chronologies bibliques.
Les chronologies bibliques diffèrent par leurs chiffres, selon qu’elles les ont empruntés à tel ou tel texte ancien, mais elles ont toutes été constituées d’une manière identique. On a pris les âges des patriarches qui nous sont donnés dans les chapitres V et XI de la Genèse, on les a additionnés ensemble, en tenant compte seulement des années pendant lesquelles ils n’avaient pas vécu simultanément, et l’on a formé de la sorte une chronologie suivie. Tous ces calculs ont, par conséquent, pour point de départ, la création de l’homme et non la création du monde, et, si l’on voulait s’exprimer avec exactitude, il faudrait dire « l’ère de la création d’Adam, » et non « l’ère de la création du monde. » Cette dernière expression confond l’origine du temps avec l’origine des années humaines : le temps commence bien avec la production de la matière, mais la chronologie ne commence qu’avec la formation de l’homme.
On n’avait pas, autrefois, il est vrai, à tenir compte, dans la supputation des années, des six jours génésiaques, que l’on regardait comme étant de vingt-quatre heures ; mais, si l’on y avait pris garde, on aurait dû remarquer que la création des éléments de la matière étant distincte de l’œuvre des six jours, il pouvait s’être écoulé un intervalle plus ou moins grand entre les deux opérations divines de la production ex nihilo et de l’ordonnance du monde, selon la juste observation du P. Petau. Quoi qu’il en soit, il est admis aujourd’hui par la presque unanimité des interprètes que Moïse ne nous dit rien sur l’espace de temps qui s’est écoulé entre la création primitive et la production de la lumière au premier jour génésiaque. Nous ignorons donc quelle en a été la durée, et il nous est impossible de savoir, d’après le texte sacré, quelle est la date de la création du monde ; cette question est également insoluble, soit que l’on admette les jours-époques, soit que l’on défende les jours de vingt-quatre heures. Nous en sommes réduits là-dessus à nous en rapporter aux savants.
Mais les calculs des savants eux-mêmes sont loin d’être certains et ne reposent pas sur des bases bien fermes. On ne peut faire que des conjectures, sur l’ancienneté de la terre et la date de la création. Tout ce que l’on peut affirmer, c’est que la terre est extrêmement ancienne et que la Bible ne nous apprend pas à quelle époque elle a été créée.
On fixe généralement, parmi nous, la création d’Adam à l’an 4,004 avant l’ère chrétienne, mais il faut observer 1° que ce chiffre repose sur des calculs contestables, et 2° qu’il est actuellement impossible de résoudre, avec une entière certitude, le problème de l’époque de l’apparition de l’homme sur la terre.
Il existe de nombreux systèmes de chronologie biblique, mais, en un certain sens, il n’existe pas de chronologie biblique proprement dite. Il n’existe pas non plus de chronologie ecclésiastique officielle. « C’est une erreur de croire, dit Mgr Meignan, que la foi catholique enferme l’existence de l’homme dans une durée qui ne peut dépasser six mille ans. L’Église ne s’est jamais prononcée sur une question aussi délicate. » L’Ancien Testament ne connait point d’ère, c’est-à-dire de point de départ fixe choisi pour compter les années et servir de terme de comparaison à tous les autres évènements, comme par exemple la date de la naissance de Jésus-Christ. Il contient néanmoins des données chronologiques, c’est-à-dire des éléments de calcul dont on peut se servir pour construire une chronologie, quoique aucun auteur inspiré ne nous présente une chronologie toute faite. Ces éléments sont les générations des patriarches et le nombre d’années pendant lesquelles ils ont vécu. Dans l’état où ils nous sont parvenus, ils sont insuffisants pour établir une chronologie rigoureuse et absolument certaine.
Pour supputer, en effet, exactement les années depuis la création de l’homme, à l’aide des tableaux des générations des patriarches, il faudrait : 1° posséder les vrais chiffres écrits par les auteurs sacrés dans le Pentateuque et dans les autres livres inspirés ; 2° avoir des listes généalogiques complètes, c’est-à-dire sans lacunes. — 1° Il est évident que si les chiffres bibliques ont été altérés et que si nous manquons des moyens nécessaires pour les rétablir dans leur intégrité, nous ne pouvons plus affirmer que tel chiffre est vrai. — 2° De plus, comme la chronologie sacrée a été construite artificiellement par l’addition de l’âge des patriarches et en partant de la supposition que la liste des générations est complète, si cette hypothèse est fausse et que Moïse ait omis une ou plusieurs générations, on voit aisément qu’il est impossible de savoir quel temps s’est écoulé, par exemple, de Noé jusqu’à Abraham ; il résulte aussi de là que toutes les chronologies données jusqu’ici sont trop courtes. Or 1° les chiffres bibliques ne nous sont pas parvenus sans altération et 2° il n’est pas constaté que les listes généalogiques soient complètes.
1° Nous n’avons aucun moyen efficace et infaillible de savoir quels ont été les chiffres primitifs de la Genèse, car tous les textes anciens que nous possédons sont en complet désaccord entre eux. Rien ne s’altère dans les manuscrits aussi facilement que les chiffres, parce que le sens de la phrase ne permet pas au copiste de discerner quel est le véritable signe qu’il doit lire dans l’original, quand cet original est mal écrit ; aussi tous les chiffres qu’on rencontre dans les copies diverses des auteurs anciens, quels qu’ils soient, grecs, latins, hébreux, sont plus ou moins contradictoires. Dieu n’a pas voulu faire un miracle pour garantir de toute altération les dates du texte sacré. Elles n’intéressent ni le dogme ni la morale, et il a jugé, dans sa sagesse, qu’il n’y avait aucun inconvénient à ce que nous restions dans l’ignorance sur la véritable chronologie. Il n’a pas voulu nous apprendre dans les Évangiles si le ministère public de Notre Seigneur avait duré un, deux, trois ou quatre ans et plus, et l’on peut apporter des raisons qui ne sont pas sans force en faveur de chacune de ces opinions ; il n’a pas jugé non plus nécessaire de nous faire savoir le nombre exact d’années qui s’est écoulé depuis la chute d’Adam jusqu’à la venue du Rédempteur.
Ainsi, par exemple, il existe une divergence d’environ 2,000 ans entre la chronologie des Septante et celle de la Bible hébraïque, reproduite par notre Vulgate. Le texte grec, qui est la plus ancienne version de l’Ancien Testament, compte 2,262 ans avant le déluge ; l’hébreu et notre Vulgate, 1,656 ; le Pentateuque samaritain n’en compte que 1,307. De Noé à Abraham, les Septante ont 1172 ans, l’hébreu et le latin 292 et le samaritain 942. De ces chiffres si divers, quels sont les vrais ? Tous même ne sont-ils pas altérés ? C’est là une question à laquelle personne ne peut répondre. La critique est impuissante à résoudre le problème. L’Église ne se prononce pas. Pendant les six premiers siècles de notre ère, les écrivains ecclésiastiques grecs et latins ont admis la chronologie des Septante. L’Église grecque l’admet encore aujourd’hui. Le martyrologe romain l’a également conservée ; il place la création 5,199 ans, le déluge 2,957 ans avant J.-C. Depuis le XVIe siècle, les critiques ont réussi à faire prévaloir généralement la chronologie du texte hébreu, qui place la création 4,000 ans et le déluge 2,500 ans avant J.-C. ; mais chaque savant a plus ou moins modifié ces chiffres : on compte plus de 200 systèmes chronologiques, tous fondés sur les données bibliques, diversement combinées entre elles ou modifiées d’après les variantes des textes (1).
2° Non seulement nous ignorons quels sont les vrais chiffres primitifs des listes généalogiques de la Bible, mais nous ignorons si ces listes mêmes sont tout à fait complètes. Tous les chronologistes ont admis, jusque dans ces derniers temps, qu’il n’y avait pas de lacunes dans la chaine des générations patriarcales, et la pensée de soulever un doute sur ce point ne s’est même pas présentée à leur esprit. Cependant, de nos jours, des exégètes se sont demandé si Moïse n’avait pas fait des omissions dans ses énumérations des premiers hommes, et ils se sont prononcés pour l’affirmative.
Il ne faut pas considérer, bien s’en faut, l’hypothèse des lacunes dans les listes généalogiques de la Genèse comme un fait démontré, excepté pour Caïnan, dont l’existence est attestée par S. Luc ; mais la seule possibilité des omissions permet de répondre à toutes les objections qu’on peut soulever au nom des diverses sciences, histoire, paléontologie, etc., contre la chronologie biblique. Si les savants parvenaient à prouver que la date qu’on assignait généralement à la création de l’homme n’est pas assez reculée, il en résulterait que les systèmes des chronologistes sont faux, mais le texte biblique demeurerait toujours lui-même hors de cause.
(1) Citons par exemple la Chronologie sainte, diffusée par la Bible de Sacy, traduction de la Chronológia sacra (80 pages in-folio) publiée en 1662 par le port-royaliste Claude Lancelot. Voici les principales dates de l’histoire du monde qu’elle propose : -4000 Création du monde, -2344 Déluge, -1917 Vocation d’Abraham, -1483 Sortie d’Égypte (Moïse), -1055 Début du règne de David, -1008 Fondation du Temple par Salomon, -975 Mort de Salomon, -536 Fin de la captivité à Babylone, -323 Mort d’Alexandre, 0 Naissance du Christ.
Nos premiers parents furent placés dans un jardin de délices que nous appelons le Paradis terrestre. Moïse nomme la contrée où il était situé Eden, Gen. II, 8 ; IV, 16, et le paradis lui-même porte dans la Bible hébraïque le nom du lieu où il était situé. Eden signifie joie, délices. Notre mot paradis se retrouve en hébreu sous la forme pardês, pour signifier, comme dans l’ancien perse (paradez), « parc, jardin planté d’arbres, enclos. »
Le texte sacré détermine la situation du paradis en disant qu’Eden était au levant (d’après le texte original, Gen. II, 8), et qu’une rivière, qui y jaillissait pour arroser le jardin, se divisait ensuite en quatre cours d’eau, capita,appelés le Phison, le Gehon, le Tigre et l’Euphrate. L’identification du Tigre et de l’Euphrate n’offre aucune difficulté : ce sont les fleuves qui ont toujours été connus sous ce nom ; celle du Phison et du Gehon au contraire est encore aujourd’hui un problème. Il est dit du Gehon qu’il coule autour de la terre de Kusch, nom qui est traduit par les Septante et la Vulgate comme signifiant l’Éthiopie, parce que l’Éthiopie a été habitée, après la dispersion des peuples, par les Kuschites ; mais ces derniers habitaient auparavant en Asie, et Kusch désigne certainement ici une contrée d’Asie.
La plupart des commentateurs, jusque dans ces dernières années, ont cru que le Paradis terrestre était situé dans l’Asie occidentale. Les uns placent Eden dans l’Arménie, les autres près du golfe Persique, au-dessous du confluent de l’Euphrate et du Tigre, lorsque ces deux fleuves ont formé le Schat-el-Arab. Un certain nombre de savants modernes pensent, au contraire, qu’il faut le chercher dans l’Inde ou sur le plateau de Pamir. D’après eux, Hévilath, le pays qu’arrose le Phison, et où l’on trouve l’or, le bdellium et l’onyx, c’est l’Inde qui est, pour les Hébreux, une contrée s’étendant indéfiniment au sud-est. Cette explication n’est pas conciliable avec le texte biblique.
Le déluge et les révolutions diverses qui ont bouleversé certaines parties de la terre peuvent avoir modifié notablement la topographie des lieux où était situé le Paradis terrestre et rendu ainsi insoluble la question de son emplacement. L’opinion qui semble la plus vraisemblable est celle qui le place en Arménie, dans les riches vallées de cette contrée qui est encore aujourd’hui l’une des plus fertiles du monde. L’Euphrate et le Tigre ont leur source dans cette région ; le Tigre nait à une heure environ de l’Euphrate, au nord de Diyarbakir. C’est en ce lieu qu’Adam dut être placé. Le Phison est ou bien le Phase des auteurs classiques, qui coule d’est en ouest et se jette dans la mer Noire, ou bien le Kur, le Cyrus des anciens, qui prend sa source dans les environs de Kars, non loin de la source occidentale de l’Euphrate, et se jette ensuite dans la mer Caspienne après avoir mêlé ses eaux à celles de l’Araxe. Hévilath, qu’arrose le Phison, c’est la Colchide, le pays des métaux précieux, où les Argonautes allèrent chercher la toison d’or. Quant au Gehon, c’est l’Aras d’aujourd’hui, l’ancien Araxe, appelé par les Arabes Djaichun, (ou Gehon) er Ras,lequel sort du voisinage de la source occidentale de l’Euphrate et va, comme nous l’avons dit, se jeter avec le Kur dans la mer Caspienne. La terre de Kusch qu’il traverse, d’après la Genèse, c’est le pays des Kosséens. « Que l’Eden… doive être cherché aux sources de l’Euphrate et du Tigre, dit un savant philologue allemand, M. Ebers, cela nous parait au-dessus de toute contestation : c’est ce qu’établissent l’ethnographie et la géographie, l’histoire hébraïque et les chroniques arméniennes, et, de nos jours, avec une autorité particulière, la philologie comparée. »
Adam mourut à l’âge de neuf cent trente ans. Tous les premiers hommes vécurent, comme lui, pendant de longues années. « Il faut bien l’avouer, dit M. Glaire, cette durée prodigieuse de la vie des premiers hommes, surtout lorsqu’on la compare avec la brièveté de la nôtre, est une des choses les plus étonnantes qu’on trouve dans l’histoire du monde avant le déluge. » Déjà du temps de S. Augustin on avait essayé de réduire la durée de la vie des patriarches, en prétendant que leurs années n’étaient que de trente-six jours, mais « l’auteur de la Genèse ne dit pas un mot qui fasse soupçonner que le mot année, dont il se sert, ait une valeur différente, selon qu’il se trouve dans tel ou tel chapitre de son ouvrage. » La mention du septième et du dixième mois de l’année du déluge, Gen. VII, 11 et VIII, 4-13, montre au contraire que les mois étaient très distincts de l’année et que celle-ci se composait au moins de trois cent soixante jours. S. Augustin a d’ailleurs justement observé que Seth ayant engendré à cent cinq ans et Caïnan à soixante-dix, si l’on appliquait à ces chiffres la réduction supposée, on les abaisserait au nombre inacceptable de dix ou sept.
« Le résultat des études de l’exégèse, à cet égard, doit donc être, dit M. Reusch, que, selon la Genèse, les patriarches vivaient beaucoup plus longtemps qu’à présent ; la durée de leur vie, à l’époque antédiluvienne, était dix fois celle d’aujourd’hui… Flávius Josèphe déjà rapporte que les historiens des autres anciens peuples, tels que Manéthon et Bérose, parlent de la longue durée de la vie des premiers hommes, comme un fait conservé par la tradition dans les contrées où ils vivaient. Ces traditions étaient également répandues chez un grand nombre d’autres peuples dont Josèphe ne parle point. »
Mais, assure-t-on, cette longévité est physiquement impossible. « Je crois que nous pouvons répondre tout simplement, dit M. Reusch : “La question de la possibilité d’une vie de cinq, six et neuf cents ans dans les premiers temps du genre humain n’est point du ressort de la physiologie actuelle. Le physiologiste qui parle d’impossibilité sur ce point sort de la réserve que lui commande la véritable science (Kurtz).” » La seule règle d’après laquelle la physiologie puisse déterminer la durée de la vie, c’est l’expérience ; or ses observations portent exclusivement sur le présent, et ses conclusions doivent se réduire à ceci : dans les conditions actuelles de la nature, l’homme ne peut arriver à un âge aussi avancé que celui auquel les patriarches sont parvenus…
Du reste, on trouve quelquefois maintenant encore des exemples suffisamment constatés de personnes qui ont dépassé de beaucoup l’âge ordinaire et ont vécu de 150 à 200 ans : Prichard cite beaucoup d’exemples de ce genre. Au dire des voyageurs modernes, cette longévité n’est pas rare chez les Arabes qui habitent les déserts de l’Afrique. Or, si à notre époque, la durée de la vie peut, dans des circonstances très favorables, atteindre le double ou le triple de la durée fixée comme moyenne par la physiologie, qui voudrait affirmer qu’il n’y a pas eu des circonstances plus favorables encore, où les hommes arrivaient à un âge dix fois plus avancé ? En ne s’appuyant que sur les faits actuels, il est aussi impossible de nier que de démontrer la réalité de ces circonstances extraordinaires dans la haute antiquité.
Nous ne savons non plus rien de certain sur la nature des causes qui permettaient aux hommes de parvenir à un âge avancé. Le milieu dans lequel l’homme vivait, et sa constitution physique elle-même, n’étaient probablement pas les mêmes qu’aujourd’hui et en différaient assez pour rendre possible une telle longévité… Avant le déluge, les conditions climatériques étaient probablement différentes de celles d’aujourd’hui ; peut-être cette circonstance entra-t-elle pour quelque chose dans la longue durée de la vie des premiers hommes, si même elle n’en fut pas l’unique cause. »
On peut entendre l’universalité du déluge en ce sens que les eaux couvrirent toute la terre habitée par les hommes, mais non toute la terre habitable. Au moment où eut lieu la grande catastrophe, toute la terre habitable n’était pas encore peuplée. Noé et Moïse n’entendaient pas, par la terre entière, le globe terrestre tel qu’il nous est connu aujourd’hui, depuis la découverte de l’Amérique et après toutes les explorations modernes, mais la partie du monde alors habitée. « Nous ne sommes pas injustes envers Noé et ses fils, non plus qu’envers le libérateur d’Israël, dit le P. Pianciani, quand nous supposons que, comme leurs contemporains et leurs descendants, ils ignoraient l’existence de l’Amérique et de l’Australie, qu’ils ne savaient rien sur ces contrées et sur les parties les plus éloignées du monde ancien, par exemple, le cap de Bonne-Espérance ; qu’ils n’avaient pas, en un mot, sur la forme particulière de ces pays et en général sur la géographie et la zoologie, des connaissances plus étendues qu’Aristote, Hipparque, Ptolémée et Pline. »
L’étude comparée des divers passages de la Bible, en particulier du Pentateuque, montre bien que c’est dans ce sens restreint qu’il faut entendre son langage. En parlant de la famine qui eut lieu du temps de Jacob, Moïse nous dit : « Dans tout l’univers, la famine prévalut… La famine augmentait chaque jour sur toute la terre… Toutes les provinces venaient en Égypte pour acheter des vivres. » Gen. XLI, 54, 56, 57. Ces passages ne doivent certainement pas s’entendre de l’univers entier, mais des peuples connus alors des Hébreux. Il en est de même de plusieurs autres passages de l’Écriture.
Les termes employés par la Genèse dans le récit du déluge s’appliquent donc seulement à la terre connue alors de Noé et des Hébreux, aux montagnes qu’ils avaient vues, aux animaux avec qui ils étaient familiers ou dont au moins ils avaient entendu parler. Par conséquent, rien n’oblige d’admettre que les plus hauts sommets de l’Himalaya, les volcans de l’Amérique centrale et méridionale et les montagnes de l’intérieur de l’Afrique ont été couverts par les eaux, puisque les anciens ne les connaissaient pas. « Quand nous lisons que toutes les hautes montagnes, sous le ciel, furent couvertes par les eaux, nous ne sommes pas plus forcés de prendre ces mots dans un sens rigoureusement littéral, dit M. Reusch, que tant d’autres expressions analogues que nous lisons dans la Bible. En plaçant ces paroles dans la bouche de Noé, nous devons entendre par ces montagnes celles qu’il avait pu voir de ses yeux. » Pour Noé, toutes les montagnes qu’il connaissait avaient été inondées par le déluge.
Le déluge n’a donc été universel que pour la terre habitée ; cette hypothèse, plus en harmonie avec les données des sciences naturelles, coupe court à toutes les objections soulevées de ce chef contre le récit de Moïse.
Comme signe de l’alliance qu’il fait avec Noé, Dieu lui donne l’arc-en-ciel. « La phrase de l’Écriture suppose, a-t-on dit, que l’arc-en-ciel ne paraissait pas avant le déluge et que le Très-Haut n’avait pas jusque là ouvert son arc. Or, ce phénomène est un effet naturel qui a dû se produire toutes les fois que les rayons solaires sont tombés sur des nuages qui se dissolvaient en gouttes de pluie. Et comment un phénomène naturel et ordinaire peut-il être un signe propre à rassurer contre la crainte de catastrophes aussi extraordinaires ? — En premier lieu, j’observe, dit le P. Pianciani, répondant à l’objection après l’avoir posée, que les Septante ne traduisent pas au futur comme la Vulgate, je poserai, mais au présent, je pose, et l’hébreu a le prétérit, j’ai posé… Je remarque, de plus, que, quoique quelques-uns, comme Alcuin et la Glose, aient déduit de ce passage qu’avant le déluge l’arc-en-ciel ne paraissait pas, la plupart des commentateurs sont d’un avis différent et pensent que, quoique un phénomène ne soit pas nouveau, il peut être choisi comme un signe, de même qu’une pierre ou une colonne déjà existante peut devenir la marque d’une limite ou d’une frontière entre deux possessions… Souvent, dit le P. Granelli, Noé avait vu l’arc-en-ciel, mais quand il l’avait vu, le déluge n’avait pas encore désolé la terre ; pendant le déluge, cet arc n’avait point brillé. C’était donc un signe très bien choisi qui, par l’expérience du passé, pouvait rassurer contre la crainte du cataclysme. »
I. Les Chamites furent les premiers, des trois grandes familles, qui s’éloignèrent du centre commun de l’humanité, se répandirent sur la plus vaste étendue du territoire et fondèrent les plus antiques monarchies. — 1° Cousch et les Couschites s’étendirent depuis la Babylonie, le long des côtes de l’Océan indien, jusqu’en Éthiopie, au sud de l’Égypte. Les inscriptions hiéroglyphiques confirment le récit de la Genèse : elles désignent toujours les peuples du Haut-Nil sous le nom de Cousch. Nemrod, le premier conquérant, le fondateur d’Erech et de Chalanné, était aussi un fils de Cousch, Gen. X, 8. — 2° Misraïm peupla l’Égypte. Les Arabes appellent encore aujourd’hui ce pays et sa capitale Misr. Les Psaumes appellent l’Égypte la terre de Cham, Ps. LXXVII, 51 ; CIV, 23 ; CV, 22, sans doute parce que c’était le pays où la race de Cham s’était élevée au plus haut degré de puissance et de civilisation. — 3° Phut peupla les côtes septentrionales de l’Afrique. On trouve, dans les inscriptions égyptiennes, des Africains nomades ainsi appelés. — 4° Chanaan habita la contrée qui prit son nom. Les Chananéens comprenaient les Phéniciens et les tribus nombreuses qui occupaient le pays renfermé entre la Méditerranée et la mer Morte avant l’établissement des Hébreux.
II. Les descendants de Sem occupèrent cette partie de la terre qui s’étend entre la mer Méditerranée et l’Océan indien d’une part, et, de l’autre, depuis l’extrémité nord-est de la Lydie, jusqu’à la péninsule arabique : au sud, Aram habita la Syrie ; Arphaxad, la Chaldée ; Assur, l’Assyrie ; Ælam, l’Élymaïde, qui devint plus tard une province de la Perse ; Jectan, l’Arabie.
III. De Japhet sortirent : 1° Gomer, père des races kymris ou celtes ; 2° Magog, des races scythes et teutoniques ; 3° Madaï, des races iraniennes (Bactriens, Mèdes et Perses) ; 4° Javan, d’Élisa, Tharsis, Kithim, Dodanim (ou Rodanim), races pélasgiques, hellènes, italiotes, etc. ; 5° Thubal, des Thubaliens, Ibères ; 6° Mosoch, des Cappadociens, etc. ; 7° Thiras, d’une partie des races scythes ou slaves. — La tradition grecque avait conservé le souvenir de l’origine asiatique de Japhet, puisqu’elle disait que Japet était l’époux de l’Asie.
Quand Dieu, par la main de Moïse, frappa l’Égypte des dix plaies, la cour du Pharaon était à Tanis. Les Hébreux habitaient au sud de cette ville, à Ramsès et à Phithom, aujourd’hui, Tell-el-Maskhûta, et dans les environs. C’est de là qu’ils partirent après avoir célébré la première Pâque, lorsque, après la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens, Ménéphtah eut enfin consenti à leur départ. Ils se dirigèrent d’abord vers le nord-est, pour aller prendre la route directe de la Palestine qui longeait le bord de la Méditerranée, jusqu’à Gaza, ville qui faisait partie de la Terre Promise ; mais au bout de deux jours de marche, Dieu leur ordonna de revenir sur leurs pas, vers le sud. Ils étaient arrivés à l’extrémité de la mer Rouge, au nord-ouest de la pointe septentrionale de ce que nous appelons aujourd’hui le golfe de Suez, lorsque Menéphtah, regrettant de leur avoir permis de partir, se mit à leur poursuite avec ses charriots. Il atteignit les Hébreux, qui se trouvèrent enfermés ainsi au sud par les eaux de la mer, à l’ouest par la chaine du Djébel Attaka, au nord, et à l’est par l’armée égyptienne. Tout était humainement perdu ; mais Dieu n’avait voulu les réduire à cette extrémité que pour se les attacher à jamais par une reconnaissance éternelle. Sur son ordre, Moïse commanda à la mer, et Israël passa de l’autre côté du golfe, entre deux murailles d’eau, qui se refermèrent sur leurs ennemis pour les engloutir quand ils essayèrent de suivre la même route. Tel fut le passage de la mer Rouge, l’un des plus grands miracles qu’enregistrent nos Saints Livres.
« Aucun endroit du monde n’était plus propice que le mont Sinaï à l’établissement de la religion mosaïque. Cette chaine de montagnes d’une hauteur vertigineuse, avec ses cimes et ses crêtes nues et bouleversées ; le profond silence de la solitude, le voisinage des gorges étroites, enclavées entre de grands murs de rochers, tout invite à la contemplation de l’Éternel. Combien ce peuple facilement impressionnable, si accessible aux émotions religieuses, dut-il être subitement saisi d’une sainte terreur, lorsque, après des marches accablantes, il trouva là le repos et le loisir nécessaires pour se livrer à ses méditations pieuses ! » (Schenkel)
Le mont Sinaï porte aujourd’hui le nom de Djébel Mouça ou Montagne de Moïse. C’est un massif élevé, de forme oblongue, d’environ 3,200 mètres de long sur 1,600 mètres de large, dirigé, dans sa plus grande dimension, du nord-ouest au sud-est. Son altitude est d’une hauteur moyenne de 2,000 mètres au-dessus du niveau de la mer ; 450 mètres au-dessus des ouadis environnants. Sa crête est hérissée d’une multitude de pics et de dômes de granit de Syène, et terminée aux deux extrémités par des pics plus élevés ; au sud, par un pic unique, de 2,244 mètres, appelé Djébel Mouça, comme la montagne elle-même ; au nord-ouest, par trois ou quatre escarpements, nommés collectivement Ras-Soufsaféh, du nom du plus haut d’entre eux, qui a 2,114 mètres au-dessus du niveau de la mer. De tous les côtés, à l’exception du sud-est, la pente est très abrupte et très rapide. Le pic méridional du Djébel Mouça s’appelait autrefois Djébel Moneidjah ou mont de la Conférence.
Le Sinaï est entouré de toutes parts par des vallées ; au nord-est, par l’ouadi ed-Deir, appelé aussi ouadi Schœib, c’est-à-dire Hobab, nom du beau-frère de Moïse ; au sud-ouest par l’ouadi el-Ledja. Ces deux ouadis se dirigent vers le nord ; le second, pour tourner autour du Ras-Soufsaféh au septentrion, et se jeter dans le premier, au point où celui-ci commence à prendre la direction du nord-est.
Au nord-ouest du Ras-Soufsaféh se déploie la large plaine d’er-Rahah, formée par l’ouadi de ce nom ; elle commence à environ deux kilomètres du pied de la montagne, et vient, par une pente douce, se confondre avec l’ouadi el-Ledja et l’ouadi ed-Deir. Elle est partout couverte d’herbages ; de tous ses points, on voit distinctement le pic du Ras.
Du côté du sud-est, les pentes sont moins abruptes ; il y a là, pendant plus d’un kilomètre et demi d’étendue, une agglomération de collines rocheuses et de ravins, laquelle sépare les rochers escarpés du Djébel Mouça proprement dit du lit de la vallée voisine, l’ouadi Sebayéh. Deux crêtes basses relient ici la montagne avec les chaines contigües et séparent les bassins de l’ouadi ed-Deir et de l’ouadi el-Ledja de celui de l’ouadi Sebayéh. À part cette exception, le Djébel Mouça-Soufsaféh est complètement isolé.
« Quoique les moines de Sainte-Catherine, suivant une tradition qui date d’une époque fort ancienne, n’attachent point d’importance au Ras-Soufsaféh et regardent le pic du Djébel Mouça proprement dit comme la véritable montagne de la loi, l’inspection des lieux empêche d’établir aucune connexion entre ce pic et la promulgation des commandements à Israël. Du côté méridional de fa montagne, il n’existe point de terrains où une multitude puisse s’assembler, et le pic lui-même est complètement invisible de la plaine d’er-Rahah, qui est le seul endroit capable de contenir une grande foule ; de là, le pic est masqué par les hauteurs intermédiaires du Ras-Soufsaféh. Aussi l’hypothèse, que le Ras-Soufsaféh et la plaine d’er-Rahah doivent avoir été le théâtre des évènements racontés dans l’Ex. XIX, XX, XXXII, a-t-elle été, dans ces derniers temps, généralement adoptée ; l’impossibilité de trouver au sud une position convenable et l’adaptation parfaite du site du nord sont définitivement établies par les plans, les photographies et les modèles rapportés en Angleterre par l’expédition du Sinaï.
Du reste, le caractère sacré du Djébel Mouça n’est point atteint par cette explication. Ce lieu peut avoir été associé à bon droit, par la tradition, avec la manifestation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent et dans les évènements postérieurs de la communication de la loi et des ordres pour la construction du tabernacle, comme le supposent son ancien nom de Moneidjah ou de la Conférence, et les autres légendes indigènes. Il a été, sans doute, d’abord révéré simplement comme le lieu où Moïse eut la vision de Dieu, sans relation avec des évènements plus généraux, et cela suffit pour expliquer sa sainteté primitive ; mais, considéré comme la scène de la promulgation du Décalogue aux tribus assemblées, non seulement le site du sud-est manque des qualités topographiques les plus essentielles, mais il ne peut soutenir un seul instant la comparaison avec er-Rahah et le Ras-Soufsaféh. » (H. S. Palmer.)
La plaine d’er-Rahah a une superficie d’environ 160 hectares ; on peut même la porter à 250 hectares, en comptant les parties par lesquelles elle s’unit aux ouadis ed-Deir et el-Ledja ; et à 310, en additionnant les 60 hectares de terrain plus ou moins uni formé par les pentes basses des collines qui bordent la plaine : l’inclinaison y est si douce qu’on voit jusqu’à cette distance la cime du Ras. Cette aire de 310 hectares forme un excellent théâtre, placé vis-à-vis du Ras-Soufsaféh, de partout visible : elle était plus que suffisante pour permettre à toute l’armée d’Israël de manœuvrer et de se mouvoir en liberté, quelque considérable qu’on suppose qu’elle ait été. Dans les vallées, à quatre ou cinq kilomètres à la ronde, l’espace était aussi amplement suffisant pour que toute la multitude d’Israël pût y camper à l’aise ; de leurs tentes mêmes, la plupart pouvaient jouir de la vue du Ras. Les chaines granitiques qui l’entourent lui donnent, de plus, des propriétés acoustiques remarquables.
Un voyageur français, qui a visité les lieux depuis l’expédition anglaise, M. Lenoir, décrit le Ras-Soufsaféh dans les termes suivants : « Le sommet du Sinaï forme un plateau presque uni, dont un des versants est à pic du haut jusqu’en bas de la montagne, dans la direction de Thor. De cette plate-forme, le panorama le plus étendu que j’aie jamais embrassé se déroulait tout autour de nous : les deux bras de la mer Rouge et du golfe Arabique se reliant à l’extrémité de la presqu’île et laissant apercevoir les rives opposées des deux mers dans un brouillard argenté qui se confondait avec l’eau A notre gauche et à notre droite, les crêtes convergentes de toutes les chaines sinaïtiques de la péninsule. Le mont Serbal et le Djébel Catherine semblaient dominer de beaucoup le Sinaï lui-même, quoique ne présentant pas un aspect aussi imposant que la montagne sainte.
Une dalle immense, formée naturellement, est indiquée comme l’endroit où Dieu apparut à Moïse et où les tables de la loi furent données. »
D’après ce que nous avons déjà dit, cette dernière tradition doit être probablement restreinte à la promulgation de la loi.
Le versant à pic du Ras est élevé de 600 mètres environ. Les personnes réunies au bas sont littéralement au-dessous de la montagne ; celles qui sont à l’extrémité de la plaine, quoique éloignées, ont encore la vue entière du sommet. N’est-ce pas à cause de cet isolement complet de la montagne par trois de ses côtés, et à cause de ce mur, qui se dresse presque perpendiculairement au-dessus de ce vaste amphithéâtre, que Moïse l’a caractérisée en disant qu’on pouvait la toucher et qu’on pouvait aisément l’entourer de barrières ? Il était impossible de trouver un lieu mieux adapté à la scène mémorable de la promulgation de la loi : la cime du Ras-Soufsaféh, la plaine d’er-Rahah, les chaines granitiques qui l’entourent, forment un immense théâtre naturel, également bien disposé pour contenir une grande foule, pour lui parler et être entendu d’elle, et il n’y a pas, sans doute, un seul autre endroit au monde qui eût été capable de rivaliser avec celui-ci.
Les formes hardies des montagnes, leur magnifique perspective, leurs proportions colossales, la vaste plaine qui se déploie comme un immense éventail à mesure qu’elle s’approche du Ras-Soufsaféh, le Ras lui-même s’élevant brusquement, comme une tribune gigantesque, à 600 mètres de hauteur, le calme et la tranquillité merveilleuse de la solitude, les teintes gracieuses du paysage, variant à chaque heure du jour, tout se réunit pour produire une impression qu’on ne saurait éprouver à un tel degré nulle part ailleurs.
On y trouve, du reste, toutes les commodités désirables à un campement de nomades. Les Hébreux purent aisément y séjourner plusieurs mois, parce que l’eau y abonde pour les hommes, et les pâturages y sont suffisants pour les troupeaux qu’avaient avec eux les enfants d’Israël. Tous les alentours de Djébel Mouça sont plus riches en herbages qu’aucune autre partie de la péninsule. Le Djébel Mouça lui-même, les collines et les vallées environnantes sont sillonnés de sources et de ruisseaux perpétuels. Un de ces ruisseaux, qui coule dans l’ouadi Schreich, peut très bien être celui dans lequel Moïse jeta le veau d’or réduit en poudre.
Il est impossible, on le concevra sans peine, de localiser avec certitude, après plus de trois mille ans, tous les incidents divers de l’histoire du séjour des Israélites au pied du Sinaï. Cependant, plusieurs des points de cette région cadrent si parfaitement avec les détails fournis par l’Exode, qu’on peut les désigner à peu près à coup sûr comme les lieux où se sont accomplis les faits racontés par Moïse.
Ainsi, le Djébel Moneidjah actuel, montagne peu élevée, située à la naissance de l’ouadi ed-Deir, à l’est du Djébel Mouça, et visible de toute la plaine d’er-Rahah offre un endroit si commode pour l’érection du tabernacle, que l’on ne peut douter qu’il n’y ait été effectivement érigé. Il était hors du camp et à une certaine distance, mais placé de telle sorte que les Israélites, de la porte de leur tente, dans la plaine, pouvaient voir Moïse quand il y entrait. Le Djébel Moneidjah remplit exactement cette condition, et, à côté, l’ouadi ed-Deir offre un espace suffisant pour que le peuple pût se réunir auprès du tabernacle.
Le Djébel Mouça actuel proprement dit, appelé autrefois simplement mont Sinaï, est vraisemblablement le mont Horeb, sur lequel Moïse eut la vision du buisson ardent et la révélation de l’essence divine, en même temps que celle du nom de Jéhovah.
L’arche était un coffre en bois de sittim ou acacia, couvert intérieurement et extérieurement de lames d’or ; elle avait environ 1 mètre 75 de longueur et 0,80 de largeur et de hauteur. Tout autour de la partie supérieure était une sorte de couronne d’or. Aux quatre angles étaient attachés quatre anneaux d’or, dans lesquels étaient passés des bâtons en bois d’acacia doré, pour la transporter plus facilement, à la tête d’Israël, d’un campement à l’autre, Num, X, 33-36. Deux chérubins d’or, placés vis-à-vis l’un de l’autre, aux deux extrémités du couvercle, que nous appelons propitiatoire, le voilaient de leurs ailes déployées. Le propitiatoire était comme le trône où résidait la majesté de Dieu, et l’arche elle-même, un signe sensible de sa présence au milieu de son peuple. Le Seigneur l’avait donnée à la race de Jacob pour satisfaire le besoin légitime des hommes d’avoir sous les yeux un objet matériel qui symbolise le culte et excite la piété. Placée dans le Saint des Saints, dans le lieu le plus sacré du sanctuaire, et d’ordinaire invisible à tous les regards comme la divinité qu’elle représentait, elle excluait ainsi efficacement toute idole du centre de la religion mosaïque.
L’arche s’appelait l’arche d’alliance, parce qu’elle contenait les tables de la loi, Ex. XXXIV, 29 ; XL, 20 ; Deut. XXXI, 26 ; Hebr. IX, 4, c’est-à-dire les deux tables de pierre sur lesquelles étaient inscrits les préceptes du décalogue, et qui étaient comme le résumé des conditions de l’alliancede Dieu avec son peuple. Le Seigneur avait voulu qu’elles y fussent renfermées, pour prêcher en quelque sorte à Israël, d’une manière permanente, la fidélité à la loi.
On a voulu expliquer naturellement le passage du Jourdain comme la prise de Jéricho. Ces explications sont en contradiction formelle avec les textes, qui font tomber les murailles de la ville devant l’arche et aux sons des trompettes sacrées, III, 7-17 ; VI. « On a essayé, dit M. Munk, de donner différentes explications du récit merveilleux de la prise de Jéricho, que les croyants se sont obstinés à prendre à la lettre et que les sceptiques ont cru devoir tourner en ridicule, mais qui est emprunté sans doute à un antique poème. Les uns ont supposé un tremblement de terre qui aurait fait crouler les murs ; d’autres ont pensé que Josué avait fait miner les murs et que les promenades inoffensives autour de la ville avaient pour but de masquer les opérations. L’hypothèse la plus probable me parait être celle d’un assaut auquel le son des trompettes et le cri de guerre avaient servi de signal. Dans le langage poétique de la tradition, on a pu dire que les murs de Jéricho s’écroulèrent au son retentissant des trompettes de guerre. » — Si cette explication était vraie, le récit du livre de Josué serait un mensonge. Il suffit de lire le chapitre VI, pour se convaincre qu’il est inconciliable avec cette interprétation et que l’auteur entend bien raconter un miracle, humainement inexplicable ; de même qu’en lisant le chapitre III, on est convaincu que le narrateur n’a pas voulu parler d’un passage à gué du fleuve, comme l’insinue M. Munk, et comme l’ont soutenu plusieurs rationalistes, mais d’un passage miraculeux.
La bataille de Macéda fut signalée par un grand miracle : l’arrêt du soleil. Ce prodige est un des faits de l’histoire sacrée contre lequel on a soulevé le plus d’objections. Nous devons reconnaitre que nous ignorons de quels moyens Dieu se servit pour l’accomplir, mais les objections ne sont pas pour cela plus fondées.
« Le récit biblique mentionne en quelques mots le fait du miracle, mais il ne décrit aucune circonstance particulière qui nous puisse diriger dans le choix d’une explication. Nous ne pouvons donc à ce sujet que hasarder des conjectures.
Ou bien 1° Dieu a réellement arrêté le globe terrestre dans sa révolution diurne, ou bien 2° il a fait que le soleil demeurât réellement visible pour Josué tout le temps nécessaire, sans que la terre s’arrêtât.
1° Contre la première explication, on objecte que l’arrêt subit de la terre aurait amené un bouleversement universel des objets terrestres, et une perturbation considérable des corps célestes, particulièrement en jetant la terre hors de son orbite, en troublant le mouvement de la lune. — La réponse est bien facile : Celui qui aurait arrêté ainsi la terre dans son mouvement est assez sage et assez puissant pour prévenir et empêcher les suites naturelles de cet arrêt. D’ailleurs l’objection tirée des perturbations des corps célestes est mal fondée, car le mouvement annuel de la terre autour du soleil et le mouvement de la lune autour de la terre sont indépendants de la rotation de notre globe sur lui-même : alors même que la terre cesserait sa révolution diurne, sa translation dans l’espace et celle de la lune n’en seraient point troublées.
2° Pour ceux qui préfèreraient la seconde explication, savoir une station apparente du soleil sans arrêt réel de la terre, il faut qu’ils admettent une déviation miraculeuse des rayons solaires pour les amener à éclairer la Palestine. Or, cette déviation, on peut concevoir que Dieu la produise immédiatement en dirigeant par sa toute-puissance, suivant une ligne convenable, la propagation des ébranlements lumineux dans l’espace ; ou bien on peut imaginer qu’il emploie pour cet effet des êtres matériels agissant sur ces rayons par réfraction ou par réflexion. On peut faire d’ailleurs beaucoup d’hypothèses différentes sur la nature, l’origine et le mode d’action de ces réfracteurs ou réflecteurs miraculeux.
En résumé, tout est possible à Dieu dans l’ordre physique ; mais il ne lui a pas plu de nous faire connaitre comment sa puissance est intervenue dans l’évènement dont nous parlent les Saints Livres. » (M. Boisbourdin.)
Depuis que les progrès de l’astronomie ont fait mieux ressortir combien le miracle opéré à la prière de Josué était extraordinaire, on a essayé d’en révoquer en doute la réalité. « Mais, toutes les objections qu’on a imaginées contre la réalité ou la possibilité de ce prodige se réduisent à rien quand on les examine de près.
Ainsi 1° l’objection que les annales des autres peuples de la terre sont muettes sur un évènement qui aurait dû être remarqué dans tout l’univers, est sans valeur puisque les annales des peuples de cette époque n’existent point et qu’il n’est pas certain que la prolongation du jour ait existé en dehors de la Palestine.
2° Les lois régulières auxquelles sont soumis les mouvements des astres ne prouvent pas non plus l’impossibilité du miracle. Les lois de la nature sont des règles établies par la volonté libre du Créateur, dont personne ne peut contester la puissance. Est-ce que l’auteur de la nature et des forces qui la régissent pourrait manquer du pouvoir nécessaire pour la diriger à son gré, de telle sorte qu’elle remplisse ses vues et ses desseins ?
3° Il faut observer, du reste, que tout en prenant les paroles du texte à la rigueur de la lettre, rien n’oblige à admettre, avec les Pères de l’Église et les anciens théologiens, un arrêt miraculeux du soleil lui-même, mais seulement un arrêt apparent.
L’auteur sacré parle conformément au langage vulgaire, sans se préoccuper de théories astronomiques, au milieu du feu de la bataille. » (Keil) On allègue contre les réponses que nous venons de rapporter la condamnation de Galilée par le Saint Office. Mais la décision du Saint Office ne nous force pas à interpréter ce passage de Josué comme il l’a fait. Un éminent canoniste, M. Bouix, dans son travail sur La condamnation de Galilée, a établi et démontré les propositions suivantes, qui suffisent pour justifier le sens donné aujourd’hui à ce texte par tous les exégètes : « Le système du mouvement terrestre est beaucoup plus ancien que celui de Ptolémée. L’enseignement en avait toujours été permis jusqu’à l’affaire de Galilée ; le tort de la congrégation fut de ne pas continuer cette tolérance. — La congrégation des cardinaux s’est trompée en déclarant fausse et opposée à l’Écriture Sainte l’opinion du mouvement terrestre, et en procédant contre Galilée à cause de cette opinion. Mais son erreur ne prouve point que l’institution du Saint Office soit mauvaise. Elle ne prouve rien contre l’infaillibilité du Pape. — Le tribunal du Saint Office eut tort d’exiger de Galilée qu’il abjurât l’opinion du mouvement terrestre. — Aucun acte pontifical ex cathedra n’a jamais approuvé ni confirmé le décret de 1616 ni la sentence de 1633. »
On s’est demandé de quel droit les Hébreux avaient chassé les Chananéens de la terre qu’ils occupaient et les avaient exterminés. — La question du droit de conquête des tribus ou des peuplades qui émigrent en pays étranger, s’en emparent de vive force et en chassent les anciens habitants, soit parce qu’elles ont été expulsées elles-mêmes de leur propre patrie et refoulées par d’autres émigrations, soit parce que leur trop grand nombre les a contraintes d’aller chercher ailleurs des moyens de subsistance qu’elles ne trouvaient plus sur le sol natal, cette question est insoluble pour la science humaine, comme la question de la guerre elle-même. Elle est une conséquence de l’existence de l’homme sur la terre, une condition de la vie et de la régénération des sociétés, une sorte de loi de l’humanité, loi mystérieuse que l’histoire constate à toutes ses pages sans pouvoir l’expliquer. Il n’existe guère aujourd’hui, sur notre globe, de terre habitable où les colons primitifs n’aient été supplantés par des envahisseurs plus forts, venus après eux. Les invasions des barbares aux IVe et Ve siècles ne sont pas un fait isolé ; il s’était produit souvent dans les siècles antérieurs, et il se répètera encore dans les siècles futurs : les mêmes causes ramèneront les mêmes effets.
Nous n’avons ni à expliquer ni à justifier une loi sociale dont le motif, connu de Dieu seul, échappe à nos faibles yeux. Quand les peuples ne peuvent plus être contenus dans leurs anciennes limites, leurs flots débordent comme un fleuve grossi, en inondant et ravageant tout sur leur passage. Ils ne se posent point de questions théoriques, ils ne songent pas au droit des gens ; ils suivent une sorte d’instinct, ils veulent vivre. Les Israélites, opprimés en Égypte, trop nombreux pour se fixer dans l’étroit désert du Sinaï, suivent la loi qui règle les migrations humaines, ils vont chercher dans la terre de Chanaan ce qu’ils n’ont pas ailleurs : l’indépendance religieuse et politique, en s’affranchissant d’un joug injuste, et des champs à cultiver pour se nourrir. Ce qui rend compte des migrations de tous les autres peuples peut rendre compte aussi de la migration d’Israël, et les incrédules ne peuvent lui refuser un certain droit de se faire, même par les armes, comme les autres peuples, une place au soleil.
Cependant il faut observer, de plus, qu’en dehors du besoin d’avoir une patrie propre, les Hébreux avaient un titre particulier de possession à la terre de Chanaan, titre dont ils avaient connaissance et qu’ils invoquaient pour justifier leur conquête : la Palestine, c’était pour eux la Terre Promise ; Dieu leur en avait fait don. Or, on ne saurait contester à Dieu la propriété de la terre qu’il a créée, Ps. XXIII, 1. Tout ce qu’on peut demander, c’est qu’il ne voue point sans motif des nations entières à l’extermination, et ce motif, Dieu l’avait, et il nous l’a fait connaitre. S’il condamnait les Amorrhéens à périr sous les coups des enfants de Jacob, c’est parce que la mesure de leurs crimes était comble, et qu’il voulait les châtier de leurs monstrueuses prévarications. La société a le droit de punir les individus de leurs fautes, à plus forte raison Dieu a-t-il celui de punir les particuliers et les peuples, selon qu’il le juge à propos dans sa justice.
Remarquons d’ailleurs que les Hébreux firent la guerre comme on la faisait de leur temps. Le livre des Juges note expressément qu’on n’infligea à quelques-uns des rois vaincus que le traitement qu’ils avaient infligé eux-mêmes à d’autres.
Enfin, il faut observer que les Hébreux n’exterminèrent pas tous les Chananéens, comme on l’a dit quelquefois. Quoique leur propre sécurité dans l’avenir et les ordres mêmes de Dieu dussent les y pousser, il resta, de fait, un grand nombre de Chananéens dans le pays conquis.
Jérusalem peut être considérée comme le centre et le cœur de la Palestine. Du Mont des Oliviers, à l’est de la ville, on voit Gabaa sur sa montagne en pain de sucre et les collines d’Hébron, dans la Palestine du sud. Jérusalem est bâtie sur la crête la plus saillante de la chaine qui traverse tout le pays depuis la plaine d’Esdrelon au nord jusqu’au désert de Juda au midi. C’est la ligne de séparation des eaux qui coulent à l’est vers le Jourdain, à l’ouest vers la Méditerranée. Tous ceux qui traversent l’intérieur de la Palestine du nord au sud doivent passer par le plateau de Jérusalem : Abraham pour aller de Béthel à Hébron, Jacob de Bersabée à Béthel, Josué de Jéricho à Gabaon, les Philistins de leur plaine de la Sephela à Machmas, Pompée en venant de la vallée du Jourdain, les croisés en venant de Tyr.
C’est pour cela que Jérusalem, sur ses collines avec son temple où Dieu habite, a fourni l’image si belle et en même temps si naturelle du Psalmiste :
La montagne de Sion ne chancèlera point,
car Dieu l’entoure pour ainsi dire du regard, comme un garde qui, du haut de son observatoire, examine tous les points de l’horizon.
Des montagnes sont autour d’elle (de Jérusalem)
Et le Seigneur est (comme) autour de son peuple (Ps. CXXIV, 2).
Jérusalem est remarquable par son élévation (Hébron est cependant plus élevée encore). Excepté du côté du sud, où, en venant d’Hébron, on descend, de tous les autres côtés, on monte à Jérusalem. Ce n’est pas qu’elle soit bâtie sur le sommet d’une montagne, comme tant d’autres villes et bourgades de la Palestine, mais elle est située à l’extrémité d’un des plus hauts plateaux du pays. Plus qu’aucune autre capitale au monde, plus qu’aucune autre ville importante de l’univers, elle est une ville de montagne. C’est pourquoi dans les Psaumes elle s’appelle simplement la montagne sainte ou la montagne de Dieu (Ps. XLVII, 2 ; XXIII, 3). On y respire l’air pur et frais de la montagne, en comparaison des rivages de la Méditerranée ou de la vallée brulante du Jourdain. Elle est assise sur ses montagnes comme sur une forteresse, au lieu d’être ouverte à tous, comme Jéricho ou Damas, Gaza ou Tyr. Elle résume en perfection le caractère de toute la contrée dont elle est devenue la capitale, elle est la montagne-trône, la montagne-sanctuaire de Dieu, la montagne où il désire habiter. Ps. LXVII, 17. Voir tout le Ps. LXXXVI. Comme Dieu habite au milieu d’elle, elle ne sera jamais ébranlée. Ps. CXXIV, 1 ; XLV, 6. Jérusalem se composait de deux villes, la ville haute et la ville basse, d’où sans doute la forme duelle de son nom en hébreu : Yerouschalaïm. La ville haute, c’était Jébus ou Sion, pris souvent pour Jérusalem elle-même dans les prophètes et dans les Psaumes, la cité dite de David. La ville basse, c’était le mont Moriah ou la cité de Salomon, au pied de laquelle était une source intarissable, le fons perénnis aquæ, dont parle Tacite (Hist., V, 12), le Flúminis ímpetus lætíficat civitátem Dei, que chante le Psalmiste, Ps. XLV, 5. Voir aussi Ps. LXXXVII, 7 hébreu ; Isaías, XII, 3 ; Ezech. XLVII, 1-5 ; Joan. VII, 37-38. C’est sur le mont Moriah que s’éleva le temple du vrai Dieu.
Ce qui fait la force de Jérusalem et l’a rendue digne de devenir la capitale de la Judée, c’est, avec sa position élevée, les deux ravins qui l’entourent et la rendent inabordable de trois côtés. Sa situation est tellement forte qu’elle fut la seule qui put résister aux Hébreux jusqu’au temps de David. Une vallée lui forme un fossé naturel et très profond au sud ; c’est la vallée de Gê-Hinnom, Ben Hinnom ou du fils d’Hinnom. Une autre vallée, également profonde et plus sombre, d’où son nom de Vallée noire ou Cedron, enveloppe la ville à l’est et va rejoindre la vallée de Ben Hinnom, pour se rendre de là, par d’étroits défilés, dans la mer Morte. Du temps de David, ces gorges devaient être encore plus profondes, avant que les débris accumulés de tant de siècles n’en eussent haussé le niveau. Elles font de Jérusalem une sorte de camp retranché et comme imprenable. En même temps, elles l’ont toujours empêché de s’étendre au nord-est, à l’est et au sud. Ces deux ravins devinrent comme sa nécropole et ils sont aujourd’hui tout remplis de tombeaux. Le Cedron et le Gê-Hinnom, en resserrant la capitale de la Judée dans leurs étroites limites, lui donnèrent cette unité compacte, que chante le Psalmiste :
Jérusalem est comme une ville
Dont les parties sont bien liées ensemble (Ps. CXXI, 3).
Elle renfermait néanmoins plusieurs quartiers, séparés dans la partie méridionale par la vallée de Tyropæon (Tyropœôn) ou des Fromagers, aujourd’hui à peu près complètement comblée. Elle pouvait d’ailleurs s’agrandir à l’ouest et au nord-ouest, et c’est ce qui a eu lieu. C’est là un avantage qu’elle avait sur plusieurs autres villes de Palestine qui, bâties sur la crête d’une montagne, comme Hébron, Samarie, Jezraël, ou dans une étroite vallée, comme Sichem, ne pouvaient pas facilement se développer. Elle avait un débouché pour son excédent de population dans ce plateau occidental qui la joint au plateau central de la Judée, malgré une légère dépression. Dès le temps de Salomon, les jardins devaient s’étendre sur ce plateau.
Du reste, même de ce côté, Jérusalem est défendue par une barrière de hauteurs qui en masquent la vue jusqu’à une très courte distance de la ville et qui ont dû toujours lui servir comme un rempart ou comme des forteresses avancées.
En tout temps, la force naturelle de Jérusalem a été augmentée par les murailles et les fortifications artificielles qu’elle a toujours eues et qui lui ont toujours été nécessaires pour la protéger contre ses ennemis, autrefois comme aujourd’hui contre les Bédouins, dont les razzias ne sont arrêtées que par des murs et, à diverses époques, contre les conquérants qui ont voulu s’en rendre maitres. Ni la nature ni les hommes n’ont pu la sauver de tous ses assaillants : elle a été prise dix-sept fois et la profondeur des ruines des maisons et des débris de toute espèce sur lesquels s’élève la ville actuelle est de 10 à 15 mètres. Voir Lam. IV, 1 ; Ps. LXXVIII, 1. Il est vrai que les tremblements de terre ont contribué pour leur part à amonceler les décombres, Am. I, 1 ; Zach. XIV, 5.
La véritable histoire de Jérusalem ne commence guère qu’à David. Jusqu’à ce prince, elle n’avait pas été une ville israélite et elle n’avait joué aucun rôle dans la formation du peuple de Dieu. Tandis que la plupart des peuples célèbres se sont élevés et ont grandi autour de la ville qui les a vu naitre et qui leur a servi comme de berceau, les Babyloniens à Babylone, les Assyriens à Ninive, les Égyptiens à Thèbes, les Athéniens à Athènes, les Latins à Rome, au contraire, les Israélites ne sont pas devenus une nation à Jérusalem. Cette cité, de même que Paris dans les Gaules, n’a été pour rien dans leur premier développement. Dans les temps primitifs, Hébron, Béthel, Sichem étaient célèbres, comme aux commencements de notre histoire, Lyon, Marseille, Narbonne, et Jérusalem était encore à peu près inconnue. Josué, Othoniel, Débora, Samuel, Saül avaient souvent passé dans son voisinage, vu ses tours et ses fortifications, mais ils n’y avaient jeté qu’un regard et avaient été loin sans doute de soupçonner l’avenir magnifique qui lui était réservé et la place importante qu’elle devait occuper dans leur histoire politique et religieuse. Si, en effet, l’origine de Jérusalem avait été basse et obscure, comme le dit Ezech. XVI, 3-5, la suite de son histoire devait avoir un éclat incomparable, et cette cité d’origine chananéenne était appelée à devenir la reine des cités. Ce qui lui valut une si grande gloire, c’est qu’elle devint la capitale du peuple élu et surtout que ce fut dans son sein que s’éleva le temple du vrai Dieu. Les livres historiques de l’Ancien Testament nous racontent le rôle politique que joua Jérusalem à partir du règne de David ; ils nous font connaitre aussi son importance religieuse, mais c’est surtout dans les Psaumes et dans les prophètes qu’elle nous apparait, sous ce dernier rapport, dans son véritable jour.
« Tous les chants nationaux, dit Herder, semblent avoir pris pour programme l’éloge de Jérusalem et de Sion. » Une foule de Psaumes sont consacrés à célébrer ses louanges, CXXI, LXXXVI, XLVII, CXXIV, CXX, etc., etc. Dans les prophètes, elle devient comme la capitale du monde entier et son nom est celui même de l’Église que doit fonder le Messie. Belle est sa situation ; elle est comme la joie de toute la terre, Ps. XLVII, 2. Centre de la théocratie et centre du monde ancien, elle deviendra le point d’attraction de tout l’univers, la montagne où afflueront tous les peuples, Jer. III, 17 ; Isaías, II, 2-4 ; Zach. II, 10, 11 ; XIV, 16-21. Sa gloire ne finira même pas avec l’histoire de Juda et d’Israël ; l’Église s’appellera la Jérusalem nouvelle et S. Jean, dans l’Apocalypse, nous dépeindra le ciel sous les traits de Jérusalem. « J’ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle descendant du ciel, parée comme une épouse qui va recevoir son époux. » Apoc. XXI, 2.
La plus grande œuvre de Salomon fut la construction du temple de Jérusalem. Il importe, pour l’intelligence de tous les livres de la Sainte Écriture postérieurs à cette époque, d’en avoir une idée nette et précise.
Le temple fut construit sur le mont Moriah, dans la partie nord-est de Jérusalem, sur des fondements qui nécessitèrent des travaux gigantesques. Il consistait en un édifice de proportions relativement restreintes et en plusieurs grandes cours. L’édifice, Beth Yehovah ou maison de Dieu, était rectangulaire ; il comprenait trois parties : un vestibule, ῾oulam ; le Saint, Qodesch ou Hékal, et le Saint des saints, Debir ou Qodesch haqqodaschim. Le Saint des saints, ayant dix mètres environ dans ses trois dimensions, était séparé du Saint par un mur et par une porte devant laquelle était suspendu un voile ou tapis. Il contenait l’arche d’alliance, que deux chérubins, de forme colossale, couvraient de leurs ailes étendues, et les tables de la loi. Le Saint, élevé de quinze mètres et long de vingt, renfermait l’autel des parfums, dix chandeliers d’or à sept branches et dix tables d’or sur lesquelles on plaçait les pains de proposition. En avant du Saint s’élevait le vestibule ou portique, de cinq mètres de longueur, de dix de largeur, et probablement de trente de hauteur. Il était séparé du Saint par une porte à deux battants, en bois de cyprès doré. Aux côtés latéraux de l’édifice étaient adossées de petites cellules.
La maison de Dieu n’était pas destinée à servir, comme nos églises, de lieu de réunion aux fidèles : c’était exclusivement la demeure du Seigneur, inaccessible aux mortels. Aucun Israélite ne pouvait y entrer. Seuls, les prêtres avaient le droit de pénétrer dans le Saint. Quant au Saint des saints, il était fermé à tous, au grand-prêtre lui-même, qui n’y avait accès qu’une fois par an.
Les cérémonies du culte et les assemblées des adorateurs de Jéhovah avaient lieu dans les parvis ou cours fermées qui entouraient le sanctuaire. 1° Une première cour était réservée aux prêtres et aux lévites. Là était l’autel d’airain ou autel des holocaustes, sur lequel brulait un feu perpétuel et sur lequel on offrait les sacrifices sanglants. À côté, étaient la mer d’airain et les divers ustensiles nécessaires pour l’immolation des victimes. 2° Une autre cour, appelée Parvis extérieur, d’un niveau plus bas que la précédente, nommée Parvis intérieur, était réservée, à l’exclusion des incirconcis, aux Israélites, qui assistaient de là à la célébration des sacrifices. Salomon n’eut pas le temps de l’achever ; elle ne fut terminée que par ses successeurs.
La topographie de l’ancienne Jérusalem est fort mal connue. Il est très difficile de se faire une idée exacte de la ligne que suivaient les murailles de la ville et de la position des portes ouvertes dans ces murailles. Voici ce qu’on peut dire avec vraisemblance sur ce sujet, pour rendre plus intelligible les livres d’Esdras et quelques autres livres de l’Écriture.
« Jérusalem, avant sa destruction par les Romains, était environnée de trois murs : le premier ou l’ancien mur ; le second mur, et le mur nouveau ou d’Hérode Agrippa. — Le premier et le plus ancien de ces trois murs commençait au nord près de la tour Hippicus ; il courait de cette tour, sur le penchant septentrional de Sion, jusqu’au Xystus, ou pont jeté sur le Tyropéon, et se terminait à la vallée, à l’ouest du Temple. De la même tour Hippicus, ce premier mur allait du côté opposé, autour de Sion, jusqu’à la porte du Fumier ou des Esséniens ; de là, il tournait, du côté du sud, vers la fontaine de Siloé, faisait ensuite un coude en tournant vers le nord, au-dessus de l’étang de Salomon et finissait à la vallée à l’orient du Temple. Ce mur avait soixante tours.
Le second mur commençait à la porte du premier mur qui était appelé Gennath ; il environnait à l’ouest et au nord l’Akra ou la ville basse et se terminait à la forteresse Antonia. Cette forteresse était placée au nord-ouest du Temple ; la porte Gennath à peu près à l’est de la tour Hippicus et près de cette tour. Sur ce second mur étaient quatorze tours.
Le troisième mur, appelé aussi le mur d’Hérode Agrippa, parce qu’il fut bâti ou du moins commencé par ce prince, prenait aussi son origine à la tour Hippicus, courait de là, vers le nord, jusqu’à la tour Pséphinas, le point le plus au nord de la ville, passait près du monument d’Hélène, et enfin se rattachait à l’ancien mur dans la vallée de Cedron. Ce troisième mur embrassait ainsi toute la partie de la ville formée, depuis son rétablissement, au nord de l’Akra et du mont Moriah. Maintenant pour ce qui regarde les portes, nous remarquerons d’abord que le deuxième livre d’Esdras ou le livre de Néhémie donne trois fois tout le pourtour des murs de Jérusalem. Premièrement, d’après le chapitre II, 13-15, Néhémie fait le tour de Jérusalem en partant de la porte de la Vallée, et après avoir visité l’enceinte de la ville, il revient à la même porte. La direction que suivit Néhémie est assez clairement indiquée en cet endroit, vers. 15 ; puisqu’il remonta le torrent de Cedron, il allait du sud au nord. En second lieu, d’après le chapitre III, où est racontée la reconstruction des murailles, cette reconstruction commence par la porte des Brebis, que construisirent les prêtres (vers. 1), et finit par la même porte des Brebis (vers. 32). La porte des Eaux (vers. 26) est placée au levant. Enfin le chapitre XII, 31-40, fait connaitre comment, après l’achèvement des murs, deux chœurs les parcoururent dans la cérémonie de la dédicace, en partant d’un même point et allant dans des directions opposées. Les deux chœurs se rencontrèrent près du Temple (vers. 40), et par conséquent à l’orient de la ville. Ils partirent donc d’un point situé au couchant (vraisemblablement de la porte de la Vallée) ; le premier chœur se dirigea à droite, c’est-à-dire vers le midi, en faisant le tour de Sion ; le second chœur prit sa direction vers le nord. Or, si l’on compare ces trois passages de Néhémie, voici, ce semble, l’ordre qu’on peut établir dans la position des portes :
Au nord : 1° La porte Ancienne, vraisemblablement à l’angle au nord-est (III, 6 ; XII, 38). — 2° La porte d’Ephraïm (de Benjamin) (XII, 38. Comparez Jer. XXXVIII, 7 ; XXXVII, 13 ; II Par. XXV, 23). — 3° La porte de l’Angle, à l’angle au nord-ouest (III, 11. Comparez II Par. XXVI, 9 ; IV Reg. XIV, 13 ; Zach. XIV, 10).
Au couchant : 4° La porte de la Vallée (II, 13 ; III, 13. Compar. II Par. XXVI, 9).
Au midi : 5° La porte du Fumier [la porte des Esséniens ( ?)] (II, 13 ; XII, 31). — 6° La porte de la Fontaine au sud-est (II, 14 ; III, 15). La porte de la Fontaine était proche de l’étang du roi (II, 14), proche aussi de l’étang de Siloé (III, 15) ; deux étangs qui peuvent bien être le même. C’est une question de savoir si la porte de la Fontaine n’est pas la même que la porte d’Argile ou du Potier qui conduisait dans la vallée d’Hennom (Jer. XIX, 2), ou si peut-être elle n’était pas située plus près de l’embouchure du Tyropéon, et la porte du Fumier au même endroit, mais un peu plus haut.
Au levant : 7° La porte des Eaux (III, 26 ; VIII, 1). — 8° La porte de la Prison et la porte des Chevaux vers le Temple (XII, 38-39 ; III, 18). — 9° La porte des Brebis [ou du Troupeau], (proche de l’étang des Brebis (?) (III, 1, 32 ; XII, 38). — 10° La porte des Poissons, tout à fait au nord (III, 3 ; XII, 38. Comparez Soph. I, 11 ; II Par. XXXIII, 14). — Entre la huitième et la neuvième porte étaient les tours Hammeah et Hananéel (III, 1 ; XII, 38. Compar. Zach. XIV, 10 ; Ezech. XLVII, 1, note 2 ; Matth. XXVII, 66). » (Gimarey.)
Le texte original dit qu’il était assis, là, sur la cendre, et S. Jean Chrysostome rapporte qu’on allait de son temps en pèlerinage vénérer l’endroit où s’était retiré alors le saint patriarche. « On sait, dit M. Edm. Le Blant, que, d’après le texte hébreu, Job était assis sur la cendre et non sur le fumier, ce qui explique mieux de la part des anciens l’admission d’une longue existence pour cet objet de vénération. » Le passage suivant fera connaitre en quel endroit s’était retiré Job et expliquera en même temps comment les Septante et la Vulgate ont pu traduire par fumier ce que l’hébreu appelle cendre, et comment le lieu sanctifié par la présence de Job s’est conservé et a pu devenir un lieu de pèlerinage : « À l’entrée de tous les villages du Hauran, dit M. Wetzstein, il y a un emplacement désigné pour déposer les immondices enlevées des étables. Ces immondices forment à la longue un monceau, qu’on appelle mezbelé et qui surpasse en volume et en hauteur les bâtiments les plus élevés du village… Le fumier qu’on porte au mezbelé n’est point mélangé avec de la paille ; dans ces pays très chauds, sans humidité, la litière est inutile pour les chevaux et les ânes, qui sont les principaux habitants des étables, parce que le menu bétail et les taureaux passent ordinairement la nuit dans les pâturages. Ce fumier est donc sec et on le transporte dans des corbeilles à l’endroit qui sert de dépôt, à l’entrée du village. On l’y brule ordinairement tous les mois, en ayant soin de choisir, pour cette opération, une journée favorable, où le vent ne pousse pas la fumée du côté des maisons. Comme le sol chaud et fertile de ces contrées n’a pas besoin d’engrais,… les cendres, produites par la combustion de ces immondices, restent là entassées et s’y accumulent pendant des siècles. Les mezbelé finissent ainsi par atteindre une grande hauteur. Les pluies d’hiver durcissent ces couches de cendre en masse compacte et les transforment peu à peu en une sorte de colline, dans l’intérieur de laquelle on creuse ces remarquables fosses à grains appelées biâr-el-galle qui garantissent le froment des ravages de la chaleur et des insectes, et le conservent pendant plusieurs années. Le mezbelé sert aux habitants du village comme de tour et de lieu d’observation ; c’est là qu’ils se réunissent, pendant les soirées étouffantes d’été, pour jouir un peu du vent frais qui souffle sur cette hauteur. Les enfants vont y jouer ; le malheureux qui, frappée d’une maladie repoussante, n’est plus supporté dans l’intérieur du village, s’y retire pour demander, le jour, l’aumône aux passants, et se coucher la nuit dans les cendres échauffées par le soleil. On y voit souvent aussi les chiens du village, attirés par l’odeur des animaux morts qu’on a coutume d’y porter. Plusieurs localités du Hauran ont perdu leur nom primitif et s’appellent aujourd’hui Umm-el-mezâbil, à cause de la hauteur et de la multitude de collines de ce genre qui les entourent et qui indiquent qu’elles sont depuis fort longtemps habitées. Quelques villages modernes sont bâtis sur d’anciens mezbelé, parce que l’air y est plus pur et plus salubre. » (Lire : Commentaire de Job par saint Thomas d’Aquin)
I. De la poésie hébraïque en général.
On ne compte d’ordinaire, d’après les Juifs, que trois livres proprement poétiques, Job depuis III, 2 jusqu’à XLII, 6, les Psaumes et les Proverbes ; mais les Lamentations, le Cantique des cantiques, Isaïe et une grande partie des prophètes sont aussi écrits dans une forme poétique particulière ou contiennent des morceaux en vers.
On s’est donné beaucoup de peine pour classer les poèmes hébreux dans les genres littéraires connus des Grecs et des Latins. Cette peine est assez inutile. La Poétique d’Aristote ne donne pas la forme nécessaire de toute poésie, et Job, pour n’être pas un drame selon le type hellénique, n’en est pas moins un magnifique poème.
La poésie de la Bible est en général lyrique. On peut la subdiviser en didactique, gnomique, élégiaque, dramatique même, si l’on veut, mais aucun de ces genres n’est parfaitement tranché ; toutes les subdivisions rentrent plus où moins les unes dans les autres, et tous les poètes d’Israël sont des lyriques, en ce sens qu’ils expriment toujours les sentiments personnels qu’ils éprouvent.
Le véritable caractère des chants hébreux, c’est qu’ils sont religieux. Dieu, qui les inspire, y occupe toujours la première place, quand il n’en est pas le sujet unique. Les Psaumes, en particulier, sont remplis de Dieu. De là l’enthousiasme, le lyrisme des poètes d’Israël, et cet accent particulier qui a fait de leurs chants les chants de l’univers chrétien.
La poésie hébraïque a cela de commun avec toutes les poésies du monde, que son langage est plein d’éclat et de magnificence. Dans toutes les littératures, les poètes se distinguent des prosateurs par un style plus brillant, plus vif, plus harmonieux et plus imagé. Les poètes orientaux ne diffèrent, sous ce rapport, de nos poètes occidentaux que par une plus grande hardiesse, une profusion plus abondante de métaphores, des hyperboles plus fortes, un coloris plus riche, dont la vivacité égale celle de leur soleil : tous ces traits se remarquent dans la poésie biblique.
Aucune partie du globe n’offre, dans un aussi petit espace, une variété pareille à celle de la Palestine. On y trouve tous les climats, les montagnes et les plaines, la mer et le Jourdain, les champs fertiles et l’aride désert, une flore et une faune variées. Quelle abondance d’images offre au poète d’Israël cette terre bénie ! Les comparaisons pleines de grâce ou de grandeur s’offrent en foule à son imagination, depuis les cèdres du Liban et les pics neigeux de l’Hermon jusqu’aux lis de la vallée et aux plantations de roses de Jéricho. Il peut contempler tous les grands spectacles de la nature, l’orage qui gronde au sommet des montagnes et les soulèvements majestueux des flots de la mer. La langue qu’il a à sa disposition, et qui est toute composée de termes concrets, vient enrichir encore d’innombrables figures le langage du poète et fournir d’inépuisables couleurs à sa palette. L’hébreu n’est pas un idiome riche ; il a cependant de nombreuses expressions pour peindre la nature et exprimer les sentiments religieux, et quel admirable usage sait en faire un artiste comme David ou comme l’auteur de Job ! Leur poésie est toujours une peinture ; elle est souvent aussi une musique. Des mots bien formés, des sons imitatifs, donnent à la pensée un merveilleux relief. Enfin, la simplicité de la syntaxe imprime aux poèmes hébreux un cachet particulier qui en augmente le charme.
Un certain nombre d’images reviennent fréquemment dans la poésie hébraïque, et il importe d’en connaitre exactement la signification pour bien comprendre nos livres sacrés. — Avant que le Christianisme eût adouci les mœurs, la guerre était beaucoup plus cruelle et plus sanglante qu’aujourd’hui ; elle n’était que meurtres et rapines sans fin ; la guerre et la violence sont par conséquent synonymes du plus grand des maux, et la paix, au contraire, signifie le bonheur et l’ensemble de tous les biens. — En dehors de la guerre à main armée, les maux dont les hommes d’alors avaient le plus à souffrir étaient d’abord l’oppression du faible par le fort, du petit par le puissant, et ensuite la tromperie et la fourberie, vices très communs en Orient.
Aussi ces deux espèces de péchés sont-elles considérées dans les Psaumes et dans les prophètes comme celles qui résument tous les autres, tandis que la justice, opposée à la violence qui opprime, et la sincérité ou la fuite du mensonge sont regardées comme la perfection, Ps. XIV, etc. La lumière du jour, grâce à laquelle on est en sécurité, est l’emblème du bien ; les ténèbres de la nuit, pendant lesquelles le méchant peut nuire plus aisément, sont le symbole du mal. L’eau qui rafraichit, la source qui fertilise le sol qu’elle arrose, l’arbre et l’ombre qui reposent, dans ces pays brulés par le soleil, sont l’image du bonheur et de la joie ; la sècheresse, l’aridité du désert, celle de l’affliction et de la souffrance.
Mais, dans toutes les langues, la poésie ne se distingue pas seulement de la prose par le style, elle s’en distingue aussi par la forme. A ce langage divin il faut un rythme, une cadence particulière, je ne sais quelle harmonieuse symétrie qui rende mieux que le terre à terre de la langue vulgaire les sentiments dont déborde l’âme, transportée par l’enthousiasme dans une région supérieure et voulant exprimer par une manière de parler extraordinaire des idées et des émotions qui ne sont pas communes. De là des règles plus ou moins difficiles auxquelles s’astreint le poète, un moule artificiel dans lequel il doit couler sa pensée.
Si le fond du style est le même chez tous les poètes, la forme de la poésie n’est pas semblable chez les différents peuples : elle varie selon le génie des langues et de ceux qui les parlent. Le vers grec et latin est mesuré par la quantité des syllabes qui le composent ; le vers français est essentiellement constitué par le nombre des syllabes et par la rime. Chez les Hébreux, nous ne rencontrons pas la rime ; d’après plusieurs orientalistes, on y trouve une certaine mesure prosodique ; mais, de l’avis de tous, ce qui distingue particulièrement la poésie hébraïque et lui donne une physionomie propre, tout à fait distincte de celle de la poésie des langues occidentales, c’est le parallélisme.
II. Du parallélisme.
C’est Lowth qui, le premier, dans ses Leçons sur la poésie sacrée des Hébreux, publiées en 1753 à Oxford, où il était professeur, a établi l’existence du parallélisme dans la poésie hébraïque. Il n’avait pas été soupçonné par les anciens ; du moins ne l’ont-ils pas signalé en tant que mécanisme poétique, et n’en ont-ils tiré aucun parti pour l’interprétation de l’Écriture.
Lowth définit le parallélisme la correspondance d’un vers avec un autre. Il l’appelle le parallélisme des membres, parce que la répétition de deux ou trois membres parallèles est un des caractères constitutifs de la poésie hébraïque, où il n’y a jamais de vers isolé. C’est une sorte de rime de la pensée, une symétrie de l’idée, exprimée ordinairement deux fois, ou quelquefois trois, en termes différents, tantôt synonymes, tantôt opposés.
Langue Cœur
du-juste des-méchants
argent choisi sans valeur.
On a comparé le parallélisme au balancement d’une fronde ; on pourrait le comparer peut-être plus justement au mouvement d’un balancier qui va et revient sur lui-même. Ces répétitions de la même pensée décèlent un trait du caractère oriental qui est plus lent que vif, qui n’a jamais attaché au temps la même valeur que nous, et s’est toujours complu dans la méditation des mêmes idées. Il faut d’ailleurs reconnaitre que le parallélisme est jusqu’à un certain point flans la nature des choses, au moins pour le chant, puisque les refrains sont de toutes les époques et de tous les pays. Nous avons dit qu’on peut comparer le parallélisme au mouvement d’un balancier. Rien n’est plus monotone en soi que la régularité de ce va-et-vient qui ne change jamais. La variété est cependant un élément nécessaire de la beauté. La monotonie ne devait-elle donc pas devenir l’écueil fatal de toutes les compositions poétiques d’Israël ? Ce danger a été évité beaucoup mieux que dans nos poèmes en vers alexandrins, grâce à la souplesse du génie hébraïque et à la diversité des combinaisons qu’il a su introduire dans le parallélisme. Il y en a quatre espèces principales qu’on appelle parallélisme synonymique, antithétique, synthétique et rythmique. 1° Le parallélisme est synonymique quand les membres parallèles se correspondent en exprimant en termes équivalents le même sens. Assez fréquemment, il y a gradation dans la pensée, quoiqu’elle reste substantiellement la même dans les deux membres. On trouve de nombreux exemples de cette espèce de parallélisme dans les psaumes. Lowth a signalé déjà, comme un des plus beaux, le psaume CXIV (selon l’hébreu, première partie du psaume CXIII, selon la Vulgate) :
Quand Israël sortit de l’Égypte,
La maison de Jacob, [du milieu] d’un peuple barbare,
Juda devint son sanctuaire,
Israël, son royaume.
La mer [le] vit et elle s’enfuit,
Le Jourdain recula en arrière,
Les montagnes bondirent comme des béliers,
Les collines, comme des agneaux.
Pourquoi l’enfuir, ô mer ?
[Pourquoi], Jourdain, reculer en arrière ?
[Pourquoi] bondir comme des béliers, ô montagnes,
[Et vous], collines, comme des agneaux ?
Tremble devant la face du Seigneur, ô terre !
Devant la face du Dieu de Jacob,
Qui change la pierre en sources abondantes ;
Et le rocher en ruisseaux d’eau [vive].
2° Le parallélisme est antithétique quand les deux membres se correspondent l’un à l’autre par une opposition de termes ou de sentiments. Cette espèce de parallélisme est surtout usitée dans les Proverbes, parce qu’elle est conforme à l’esprit de la poésie gnomique : l’antithèse fait mieux ressortir la pensée qui est le fond de la sentence et de la maxime :
Les coups de l’ami sont fidèles,
Les baisers de l’ennemi sont perfides.
L’homme rassasié dédaigne le miel.
L’affamé [trouve] doux même ce qui est amer.
On en rencontre aussi de beaux exemples dans les Psaumes :
Ceux-ci se confiaient dans leurs charriots, ceux-là dans leurs [coursiers].
Et nous dans le nom de Jéhovah, notre Dieu.
Ils ont fléchi, ils sont tombés ;
Et nous, nous sommes debout, nous sommes fermes.
Ps. XIX (XX), 8-9.
3° Le parallélisme est synthétique quand il consiste seulement dans une ressemblance de construction ou de mesure : les mots ne correspondent pas aux mots et les membres de phrase aux membres de phrase comme équivalents ou opposés par le sens, mais la tournure et la forme sont identiques : le sujet répond au sujet, le verbe au verbe, l’adjectif à l’adjectif et la mesure est la même. La seconde partie du Ps. XVIII (XIX), Cæli enárrant glóriam Dei, contient des exemples remarquables de parallélisme synthétique :
La loi de Jéhovah est parfaite,
Récréant l’âme ;
Le précepte de Jéhovah est fidèle,
Instruisant le simple ;
Les commandements de Jéhovah sont justes,
Réjouissant le cœur ;
Le décret de Jéhovah est pur,
Éclairant les yeux…
Plus désirable que l’or,
Que des monceaux d’or ;
Plus doux que le miel,
Que le rayon de miel.
4° Le parallélisme est néanmoins quelquefois simplement apparent et ne consiste que dans une certaine analogie de construction ou dans le développement de la pensée en deux vers. Il est alors purement rythmique et se prête par là même à des combinaisons infinies. Les poètes hébreux en font un usage assez fréquent, et c’est surtout grâce à lui et aux formes multiples qu’ils savent lui donner qu’ils ont réussi à éviter la monotonie à laquelle semblait les condamner fatalement la forme même de la poésie hébraïque.
Ils ont su introduire la variété dans toutes les formes de parallélisme par une multitude de procédés ingénieux dont nous n’énumèrerons qu’un petit nombre.
1° Tantôt le verbe exprimé dans le premier membre est sous-entendu dans le second :
Quand Israël sortit de l’Égypte,
La maison de Jacob — [du milieu] d’un peuple barbare,
Juda devint son sanctuaire,
Israël — son royaume.
Ps. CXIII, 1-2.
2° Tantôt le sujet du premier hémistiche devient régime du second :
Dans l’iniquité j’ai été formé,
Et dans le péché ma mère m’a conçu.
3° Ou bien le discours direct est substitué à l’indirect :
Il est bon de louer Jéhovah,
Et de chanter ton nom, ô Très-Haut.
4° Le parallélisme strict est rompu par l’emploi de diverses figures, de l’inversion, de l’interrogation, de l’exclamation, de l’ellipse :
Mon âme est troublée, beaucoup,
Et toi, Jéhovah, jusqu’à quand ?
Ils crient au secours… et point de sauveur,
Vers Jéhovah… et il ne leur répond pas.
5° Le sens, suspendu dans le premier membre, n’est terminé que dans le second, et le parallélisme est indiqué par la répétition des mêmes mots :
Louez, serviteurs de Jéhovah,
Louez le nom de Jéhovah.
Ces moyens de varier le parallélisme, empruntés à la grammaire et à la rhétorique, ne sont pas les seuls qu’aient employés les poètes d’Israël. Ils ont eu recours encore à d’autres, qui modifient davantage la forme poétique et produisent une diversité plus grande.
1° La pensée que veut exprimer le poète embrasse quelquefois quatre membres, et alors, par un procédé analogue à celui de nos vers à rimes mêlées ou croisées, les membres parallèles ne se suivent pas deux à deux, mais sont intervertis, de sorte que, par exemple, le premier est parallèle avec le dernier et le second avec l’avant-dernier.
Mon fils, si ton cœur est sage,
Mon cœur se réjouira.
Mes reins tressailliront d’allégresse,
Quand tes lèvres profèreront des paroles sensées.
Prov. XXIII, 15-16.
Dans l’exemple suivant, le premier membre répond au troisième, et le second au quatrième :
J’enivrerai mes flèches de sang,
Mon épée se nourrira de chair,
Du sang des morts et des captifs,
De la tête des chefs ennemis.
2° Les parallélismes synonymique et antithétique sont quelquefois employés simultanément :
La vérité germera de la terre,
La justice poindra des cieux.
3° Le nombre des membres parallèles peut être multiplié et porté à trois ou même à quatre. Il est de trois dans cette imprécation de David, Ps. VII, 6 :
Que l’ennemi me poursuive et m’atteigne,
Qu’il foule ma vie aux pieds,
Qu’il me réduise en poussière !
Le Ps. XC, 5-6, nous présente quatre membres parallèles consécutifs, combinés deux à deux avec beaucoup d’art :
Ne crains point les terreurs de la nuit,
Ni la flèche lancée dans le jour,
Ni la peste qui s’avance dans l’obscurité,
Ni la contagion qui exerce ses ravages en plein midi.
4° Enfin la diversité de mesure dans le vers, c’est-à-dire du nombre de mots ou de syllabes mesurées qui le composent régulièrement, permet d’introduire un nouvel élément de variété dans le parallélisme, en alternant les vers de diverses mesures ou en les mêlant au gré du poète. Nous en avons cité plus haut un exemple, tiré du psaume Cæli enárrant glóriam Dei, à propos du parallélisme synthétique ; en voici un autre exemple, emprunté au Ps. XIV (Vulgate, XIII) :
L’insensé a dit dans son cœur :
Dieu n’est pas.
Ses œuvres sont corrompues, abominables ;
Nul n’agit bien.
Seigneur, du haut du ciel, jette les yeux
Sur les enfants des hommes,
Pour voir s’il est un homme sage,
Cherchant Dieu.
Tous ont dévié, tous sont pervertis ;
Nul n’agit bien !
Tout ce que nous avons dit jusqu’ici du parallélisme montre clairement quel avantage offre cette forme particulière de la poésie hébraïque, pour faire passer cette dernière dans une langue différente, sans lui enlever complètement son cachet. Celles des formes poétiques qui consistent exclusivement dans la mesure prosodique ou la rime des mots, disparaissent nécessairement dans les traductions ; au contraire, le parallélisme existant d’ordinaire, non dans les sons, mais dans la pensée même, peut être aisément conservé. On dirait que Dieu, qui voulait que les poèmes qu’il avait inspirés aux chantres d’Israël devinssent le chant et la prière de l’Église universelle et du monde entier, voulut aussi qu’ils fussent jetés dans un moule poétique capable d’être facilement transporté dans toutes les langues parlées sous le ciel.
L’étude du parallélisme a donc une véritable importance
littéraire, et puisque Dieu a voulu qu’une partie de la parole révélée nous fût
transmise sous forme de poèmes, il ne peut pas être indifférent pour un
chrétien de connaitre les règles et les lois qui le régissent. Mais là n’est
pas cependant le principal intérêt de cette étude. Elle a une utilité plus
grande encore. S’il nous est avantageux de connaitre les beautés littéraires de
la Bible, il l’est bien davantage d’en pénétrer le sens. Or, la connaissance du
parallélisme est un moyen puissant de mieux saisir la signification d’un grand
nombre de passages, qu’on rencontre précisément dans les livres les plus
obscurs et les plus difficiles de la Sainte Écriture. Bien des endroits des
Psaumes, par exemple, deviendront clairs et intelligibles à qui leur appliquera
pour les comprendre les règles du parallélisme synonymique ou antithétique.
Ainsi le sens d’in virtúte tua, dans le passage
suivant du Ps. CXXI, 7 :
Fiat pax in
virtúte tua
Et abundántia in
túrribus tuis
est déterminé par le parallélisme. Puisque in virtúte correspond à in túrribus, il doit avoir un sens analogue et désigner par conséquent ce qui fait la force de Jérusalem et lui assure la paix, c’est-à-dire ses murailles, comme l’a traduit S. Jérôme dans sa version des Psaumes sur l’hébreu, in muris tuis. De même, Ps. LXXV, 3 :
Et factus est in pace locus ejus,
Et habitátio ejus in Sion,
le mot in pace doit désigner Jérusalem, Salem, séjour de la paix, parce qu’il correspond à Sion. Le parallélisme sert même quelquefois à déterminer la vraie leçon. Ainsi il prouve que dans le verset 17 du Ps. XXI, qui a une si grande portée, il faut lire avec notre Vulgate, kâ’arou, « ils ont percé, » et non kâ’ari, « comme un lion, » ainsi que le porte le texte massorétique, parce que cette dernière leçon détruit le parallélisme :
Ils ont percé mes mains et mes pieds,
Ils ont compté tous mes os.
III. Le vers hébreu
L’existence d’un vers hébreu, constitué soit par la quantité prosodique des mots, soit par le nombre des syllabes, est tellement évidente dans le texte original, qu’on ne peut sérieusement la contester, quoiqu’on n’ait pas songé pendant longtemps à la remarquer. Chaque membre du parallélisme forme un vers dans la poésie hébraïque.
L’élément constitutif du vers hébreu, c’est la quantité prosodique, selon les uns, le nombre des syllabes, selon les autres. Cette dernière opinion est la plus probable.
Le vers le plus usité chez les Hébreux semble être le vers heptasyllabique ou de sept syllabes. Le livre de Job. III-XLII, 6, et celui des Proverbes tout entier, ainsi que la plupart des Psaumes, sont en vers de cette mesure. Il y a des vers de quatre, de cinq, de six et de neuf syllabes, etc., alternant quelquefois avec des vers de mesure différente.
IV. Des strophes.
Un très grand nombre de poèmes de l’Ancien Testament sont partagés en strophes. La strophe est comme une prolongation du parallélisme, une sorte de rythme soutenu pendant une série de vers et superposé au rythme de chaque vers particulier. Ce qui constitue essentiellement la strophe, c’est qu’elle renferme une idée unique ou particulière, dont l’ensemble de vers qui la forment contient le développement complet. Chaque vers n’est qu’un anneau de la chaine totale, qui est la strophe. La strophe est une des règles de la poésie lyrique, dans la plupart des langues. En hébreu, on ne la rencontre pas seulement dans les Psaumes, où le chant en chœur la rendait indispensable, mais aussi dans le livre de Job, où les pensées se partagent en groupes très distincts, mais naturellement moins réguliers pour la longueur que dans l’ode.
F.-B. Köster est le premier qui ait remarqué, en 1831, l’existence des strophes dans la poésie hébraïque. Aujourd’hui elle est admise par tous les orientalistes. On peut être en désaccord pour la détermination des strophes dans un poème donné ; on est unanime à accepter le principe. Dans quelques psaumes, la division strophique est si évidente qu’il suffit de les lire pour qu’elle s’impose. Tel est, par exemple, le Ps. III, qui se compose de quatre strophes de quatre vers (sauf la quatrième qui en a cinq) exprimant chacune une idée particulière :
Jéhovah, que mes ennemis sont nombreux !
Nombreux ceux qui s’élèvent contre moi,
Nombreux ceux qui disent de moi :
Point de salut pour lui en Dieu. — Sélah.
Mais toi, Jéhovah, tu es mon bouclier,
Ma gloire, celui qui relève ma tête.
Ma voix invoque Jéhovah
Et il m’exauce de sa montagne sainte. —
Sélah
Moi je me couche et je me réveille sans inquiétude,
Parce que Jéhovah est mon soutien.
Je ne crains pas la multitude du peuple
Qui tout autour de moi me tend des pièges.
Lève-toi, Jéhovah ! sauve-moi, ô mon Dieu
Frappe mes ennemis à la joue,
Brise les dents des méchants.
À Jéhovah le salut !
Sur ton peuple ta bénédiction. — Sélah.
V. Poèmes acrostiches ou alphabétiques.
Il existe en hébreu un poème d’une forme particulière, dont il nous reste à parler pour achever de faire connaitre l’art poétique d’Israël ; c’est le poème alphabétique, dans lequel chaque vers ou chaque série parallèle de vers commence par une lettre de l’alphabet, reproduit selon l’ordre reçu. C’est donc une sorte d’acrostiche. Ce genre de composition parait avoir été adopté, de préférence, pour aider la mémoire, à retenir les vers, quand la suite des idées n’était pas très marquée.
Les Psaumes CXI et CXII sont composés chacun de vingt-deux vers, commençant par les vingt-deux lettres de l’alphabet. Les membres parallèles sont doubles dans les huit premiers versets, formés par les seize premières lettres. Le parallélisme a trois membres dans les deux derniers versets, et par conséquent six vers, commençant par les six dernières lettres. Dans le Ps. CXIX (Vulgate, CXVIII), il y a vingt-deux stances de seize vers chacune. Le premier membre parallèle de chaque stance commence par la même lettre. Ce sont là les seuls exemples de Psaumes alphabétiques parfaitement réguliers. L’éloge de la femme forte dans les Prov. XXXI, 10-31, est aussi un poème alphabétique tout à fait régulier, de même que les deux premiers chapitres et le quatrième des Lamentations. Dans le troisième chapitre, chaque lettre de l’alphabet est répétée trois fois et l’ordre est exactement suivi, excepté pour le phé, qui est placé avant l’aïn, au lieu de le suivre. Les Psaumes XXV, XXXIV, XXXVII, CXLV et surtout IX-X sont des poèmes alphabétiques irréguliers.
῾Alamôth (῾al), pro arcanis, XLV, 1. Cette expression très obscure est expliquée par beaucoup de critiques comme signifiant une voix de soprano et indiquant que le Psaume est destiné à être chanté par une voix de ce genre. — Les Pères ont entendu pro arcánis (et pro occúltis, IX, 1), tantôt des mystères de la passion, de la mort et de la résurrection de Notre-Seigneur, tantôt de la manière dont il conduit son Église.
Arcana, pro
arcánis, XLV, 1. Voir ῾alamôth.
῾Ayyéleth asch-schakhar (῾al), Vulgate, pro susceptione matutína, “la biche de l’aurore,” XXI, 1. Ce titre indique qu’il faut chanter le Psaume sur l’air, connu des Hébreux, du chant qui commençait par ces mots.
Cánticum. Voir Schîr.
Carmen. Voir
Neginôth.
Commutáre,
Pro iis qui commutabúntur, XLIV, 1 ; LXVIII, 1 ; LXXIX, 1. Voir
Schoschannîm.
Conféssio, confitéri, louange ; louer. — In confessióne, dans le titre du Ps. XCIX, voir Thôdah.
Corrúmpas
(ne), LXXIV, 1. Voir Thaschkhêth.
Degré. Voir
Ma’alôth.
Dispérdas
(ne). Voir Thaschkhêth.
Doctrínam (in). Dans le titre du Ps. LIX, pour l’enseignement, l’instruction.
῾Êdouth, témoignage, mémorial ou déclaration, mot obscur ; Vulgate, testimónium, LXXIX, 1 (et LIX, 1, où la Vulgate l’omet).
Extase, éxtasis, grec ἔκστασις, enlèvement hors de soi, XXX, 1. Ce mot n’a pas de correspondant dans le texte hébreu.
Fin, finem (in). La Vulgate a traduit par ces mots, d’après le grec, l’hébreu lamnatséakh, qui se lit en tête de 55 psaumes, et signifie au chef de chœur, ou au maitre de musique. C’est une sorte de dédicace ou d’envoi, signifiant que le psaume doit être remis à celui qui présidait le chœur des Lévites pour le faire chanter. La traduction des Septante, εἰς τὸ τέλος, in finem, est expliquée par quelques commentateurs dans le sens d’une indication musicale équivalente au fortissimo de la musique moderne. Il est plus probable que l’auteur de la version appliquait par là le psaume à la fin des temps, c’est-à-dire au Messie.
Gittith (῾al), Vulgate : pro torculáribus, VIII, 1 ; LXXX, 1 ; LXXXIII, 1. Signification incertaine. Cithare de Geth, telle qu’elle était en usage à Geth, ou d’après un mode musical en usage dans cette ville philistine que David avait habitée. Les Septante et, par suite, la Vulgate ont traduit comme s’il y avait Gitthôth au lieu de Gitthîth, pour les pressoirs, dans la pensée sans doute que les psaumes où on lit ce mot avaient été composés pour les fêtes des vendanges, Judic. IX, 27 ; Is. XVI, 8, 10 ; Jer. XLVIII, 33.
Gradus. Voir
Ma’alôth.
Héritage, Hæréditas, pro ea quæ hæreditátem conséquitur. Voir Nekhilôth.
Hymne, Hymnus. Voir Schîr.
Idithun (ipsi et pro), XXXVIII, 1 ; LXI, 1. Ce titre indique que le Psaume est adressé à Idithun, l’un des trois chefs de chœur du temps de David, I Par. XVI, 41.
Immutáre, LIX, 1. Voir Commutáre.
In finem. Voir Finem.
Inscríptio (títuli).
Voir Mikthâm.
Intelléctus, intelligéntia. Voir Maskil.
Lamnatséakh. Voir Menatséakh.
Laudátio, nom du Ps. CXLIV.
Voir
Thehillâth.
Lehazkir.
Voir Rememoratiónem.
Ma’alôth, Vulgate (cánticum) gráduum. Nom donné à 15 Ps. CXIX-CXXXIII, et expliqué de façons très diverses. Quelques-uns ont pensé qu’il désignait un rythme particulier, le rythme par gradation, consistant en ce que le sens avance par degrés et monte en quelque sorte de verset en verset, comme dans le Ps. CXX :
1. Levávi óculos meos in montes,
Unde véniet auxílium mihi.
2. Auxílium meum a Domino,
Qui fecit cœlum et
terram.
3. Non det in
commotiónem pedem tuum,
Neque dormítet qui custódit te.
4. Ecce non dormitábit neque dórmiet,
Qui custódit Israël.
5. Dóminus custódit te,
Dóminus protéctio tua…
6. Dóminus custódit te ab omni malo,
Custódiat ánimam tuam Dóminus.
7. Dóminus custódiat intróitum tuum et éxitum tuum,
Ex hoc nunc et usque in sǽculum.
Le rythme par gradation est assez fréquent dans la poésie hébraïque, et il se rencontre en particulier dans les psaumes graduels ; il n’est pas certain cependant que leur nom dérive de cette particularité. L’opinion la plus commune est que les psaumes graduels, généralement courts, et exprimant, pour la plupart, la reconnaissance d’Israël envers son Dieu, sont ainsi nommés parce qu’ils étaient chantés par les Juifs quand ils allaient en pèlerinage à Jérusalem. Ma’alôth signifie chant des montées ; or, les voyages à Jérusalem sont appelés montées dans la Bible, à cause de la position élevée de la ville et du temple, I Esd. VII, 9 et suiv. ; Ps. CXXI, 4 ; cf. CXX, 1 ; CXXIV, 1-2. Cette explication est confirmée par le contenu des Psaumes graduels et par les anciennes versions d’Aquila, de Symmaque et de Théodotion, qui ont traduit ma’alôth par ἀναβάσεις.
Maëleth.
Voir Makhalath.
Maheleth.
Voir Makhalath.
Makhalath, Vulgate : Maheleth, Maëleth, LII, 1 ; LXXXVII, 1, signifie probablement maladie, et s’applique à un psaume composé à l’occasion d’une maladie.
Maskil, Vulgate : intelléctus, intelligéntia ; Maskil signifie proprement intélligens, intelligéntem fáciens ; poème didactique, instructif (XXXII, 8 ; Vulg., XXXI, 8, ’askilka, je t’instruirai, intelléctum tibi dabo. Cf. XLVI, hébr., XLVII, 8), C’est le nom de 13 Psaumes : XXXI ; XLI ; XLIII ; XLIV ; LI ; LII ; LIII ; LIV ; LXXIII ; LXXVII ; LXXXVII ; LXXXVIII ; CXLI.
Menatséakh, lamnatséakh, Vulg. in finem, au chef de chœur, IV, 1, et dans 54 autres Psaumes. Cf. I Par. XV, 21 ; II Par. II, 1,17 ; Hab., III, 19. Voir Finem.
Mikthâm, Vulgate : títuli inscríptio (fait pour être gravé sur une stèle), nom de 6 psaumes, XV ; LV-LIX (et du chant d’Ézéchias, Is. XXXVIII, 9). Le sens de ce mot est obscur. Quelques-uns pensent qu’il veut dire poème doré et indique l’excellence du chant. D’autres l’expliquent comme signifiant psaume d’un sens profond, caché,
Mizmôr, Vulgate, psalmus, composition rythmique destinée à être chantée avec accompagnement de musique et spécialement de la harpe. Ce nom est donné à 57 psaumes qui ont pour objet de célébrer les louanges de Dieu.
Mouth labbên (῾al), Vulgate ; pro occúltis, IX, 1. Les Septante (et la Vulgate), Théodotion et Aquila ont lu ῾alamôth, comme XLV, 1. Voir ῾alamôth. Le sens de ῾al mouth labbên, « sur la mort du fils, » si cette leçon est exacte, est peut-être que le
Ps. IX devait se chanter sur l’air connu qu’on désignait par ces mots.
Neginôth (bi ou ῾al), Vulgate : in carmínibus, IV ; VI ; LIII ; LIV ; LX ; in hymnis, LXVI ; in láudibus, LXXV, avec accompagnement d’instruments à cordes.
Nekhilôth (’el), Vulgate : Pro ea quæ hæreditátem conséquitur. On croit aujourd’hui communément que nekhilôth désigne la flûte et indique, dans le titre V, 1, que le psaume devait être chanté avec accompagnement de cet instrument. Les Septante et la Vulgate ont pensé, dans leur traduction, au peuple d’Israël qui est l’héritage de Dieu ; Deut., IV, 20 ; IX, 26 ; Ps. XXVII, 9, et à l’Église, Act. XX, 28 ; Rom. VIII, 17 ; Gal. IV, 26 sq.
Occúltis (pro). Voir ῾Alamôth.
Octáva (pro). Voir Scheminîth.
Orátio, nom de cinq psaumes. Voir Thehillâh.
Psalmus, psaume. Voir Mizmôr et Schiggayôn.
Rememoratiónem (in), hébreu lehazkîr, pour faire souvenir, XXXVII ; LXIX.
Sancti. Qui a
sanctis longe factus est. Voir Yonath ’élem
rekhoqîm.
Scheminîth (῾al), Vulgate, pro octáva, VI, 1 ; XI, 1, à l’octave, avec des voix de basse ; Cf. I Par. XV, 21. — Les Pères ont entendu pro octáva du dimanche, de la régénération par la pénitence, du bonheur du ciel qui suit les sept époques que doit durer le monde présent, de la perfection, etc.
Schiggayôn, Vulgate, psalmus, ode irrégulière et dithyrambique, nom donné au Ps. VII.
Schîr, Vulgate, cánticum et hymnus, chant en général, et plus spécialement chant d’action de grâces, soit pour un bienfait privé, XXIX, soit pour des bienfaits publics, XLV ; XLVII ; LXIV, etc. Joint souvent à mizmôr.
Schoschannîm (῾al), ou Schouschan, LIX, 1. Vulgate, pro iis qui commutabúntur, XLIV, 1 ; LXVIII, 1. Schoschannîm signifie proprement les lis, et désigne d’après les uns un air connu, d’après d’autres, un instrument de musique. Les Septante ont lu schéschônîm au lieu de schoschannîm, d’où la traduction : pro iis qui commutabúntur, c’est-à-dire pour les hommes qui seront changés par la venue du Messie.
Sélah, 71 fois dans 39 Psaumes, La signification de ce mot n’est pas sûrement connue ; c’est un signe musical qui correspond au forte de la musique moderne ou bien indique une pause.
Suscéptio matutína, Voir ῾Ayyeleth asch-schakhar.
Thaschkhêth (῾al), Vulgate : ne dispérdas ou ne corrúmpas, LVI, 1, etc. Sur l’air du chant connu sous le nom de ῾al thaschkhêth.
Thehillîm, Thehillâh, Vulgate : laudátio, nom donné par les Hébreux à la collection des Psaumes et au Ps. CXLIV.
Thephillâh, Vulgate : orátio, prière ; nom donné aux Ps. XVI, LXXXV ; LXXXIX ; CI ; CXLI. Cf. LXXI, 20.
Thôdah,
mizmôr lethôdah, titre du Ps. XCIX :
Psaume de louange. Vulgate :
Psalmus in confessióne.
Títulus. Voir Mikthâm.
Torculáribus
(pro). Voir Gittîh.
Yonath ῾élem rekhoqîm (῾al), la colombe muette du lointain, Vulgate : qui a sanctis longe factus est, LV, 1, indique l’air sur
lequel le Ps. LV devait être chanté.
L’unité de poids des Hébreux était le sicle. — Le sicle se subdivisait en béqah ou demi-sicle, de baqa’, “diviser, partager”, et le béqah en gérah, grain, Vulgate, obole ; il fallait dix gérah pour faire un béqah et deux béqah, pour faire un sicle.
Fig. 1. — MINE D’ANTÍOCHUS IV ÉPIPHANE.
Du temps des rois, et après la captivité de Babylone, l’Écriture mentionne aussi la mine, en latin, mina, mna ; en hébreu, mâneh1. Sa valeur était probablement de 50 sicles, de sorte qu’il en fallait 60 pour faire un talent2. Sous les Macchabées, elle équivalait à cent sicles. — Le talent, taléntum, était le poids le plus élevé ; il s’appelait en hébreu kikkar, c’est-à-dire, rond, objet rond, parce qu’il avait sans doute une forme ronde. Il valait 3,000 sicles.
Les poids étaient primitivement des pierres, ῾abânim. Pour en assurer la régularité et prévenir les contestations ou y mettre fin, Moïse fit déposer dans le tabernacle des étalons qu’on appelait poids du sanctuaire. Ces étalons furent déposés plus tard dans le temple de Jérusalem et confiés à la garde des prêtres. Nous ignorons quelle était la forme de ces étalons. Chez les Assyriens et les Égyptiens, ils avaient la forme d’animaux. Dans les transactions ordinaires, le vendeur et l’acheteur se servaient de balances, qu’ils portaient toujours à la ceinture, avec des pierres d’un poids déterminé.
Le rapport des poids hébreux avec notre système décimal a été établi par les sicles d’argent des Macchabées que l’on a retrouvés et qui étaient probablement de même valeur que ceux de Moïse.
Fig. 2. — POIDS ASSYRIEN DE DEUX MINES (DU PALAIS DE SENNACHÉRIB).
|
1 Gérah = |
|
|
|
0,708 g |
|
10 |
1 Béqah = |
|
|
7,1 g |
|
20 |
2 |
1 Sicle = |
|
14,2 g |
|
1 000 |
100 |
50 |
1 Mine = |
708,85 g |
|
60 000 |
6 000 |
3 000 |
60 |
1 Talent = 42 533, 1 g |
Le Nouveau Testament mentionne une espèce de poids inconnu aux anciens Juifs, la λίτρα ou libra (livre). C’était un poids romain qui se subdivisait en douze onces et est estimé 326 gr. 327. Il était représenté primitivement par une masse de cuivre qu’on appelait as et d’où vint la monnaie de ce nom.
1 Pour la mine du temps des Machabées, voir Fig. 1 : Poids en plomb du Cabinet des médailles. On lit autour : ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΘΕΟ[Υ] ΕIIΙΦΑΝΟΥΣ MNA (mine du roi Antiochus Théos Épiphane). La Victoire, debout, entre deux étoiles, tenant dans la main droite une couronne et dans la gauche une palme. Mine de poids faible, pesant 516 grammes.
2 La mine, d’après Ezech. XLV, 12, aurait valu 70 sicles, mais la leçon que nous lisons dans la traduction grecque du passage de ce prophète, et qui porte 50 au lieu de 70, paraît préférable.
3 Voir Figures 2 et 4.
1° MESURES DE LONGUEUR ET DE SUPERFICIE.
I. Mesures de longueur dans l’Ancien Testament. — Les Hébreux, comme tous les autres peuples de l’antiquité, se servirent d’abord, pour mesurer les longueurs, de diverses parties du corps humain. — 1° On peut considérer comme unité de mesure la coudée, hébreu, ammâh, équivalant à la longueur de l’avant-bras ou à la distance du coude à l’extrémité du médius ou troisième doigt. L’évaluation n’en est pas certaine ; on peut l’estimer approximativement à 0,525 m. — 2° La coudée se divisait en deux empans ou grands palmes, hébreu, zéreth (Septante : spithama), mot qui signifie paume de la main et marque la distance comprise entre le pouce et le petit doigt étendus.4 — 3° Le zéreth se subdivisait en trois, téfakh ou tofakh, palmus, petit palme, mesure de la largeur de la main ou de quatre doigts, comme le rend quelquefois la Vulgate. Le téfakh est employé métaphoriquement pour désigner quelque chose de très court :
Tu m’as donné des jours de [quelques] palmes. Ps. XXXVIII, 6.
— 4° Le doigt ou pouce, hébreu, ῾etsba’, était le quart du téfakh ou palme et équivalait à l’épaisseur du doigt. Dans le texte hébreu, ce mot ne désigne une mesure qu’en un seul passage, et encore y est-il question de quatre doigts, c’est-à-dire d’un téfakh. — 5° Dans le livre des Juges, pour déterminer la longueur de l’épée à double tranchant d’Aod, il est question d’une mesure appelée en hébreu, gômed, laquelle n’est mentionnée nulle autre part dans les Livres Saints. La Vulgate la traduit par paume de la main ; les versions orientales, par aune. La dimension en est incertaine. Plusieurs savants croient qu’elle est la même que celle de la coudée. — 6° Ézéchiel parle dans ses prophéties, pour mesurer les bâtiments, d’une mesure particulière de plus grande dimension que les précédentes, qânéh, cálamus mensúræ, la canne5. On croit généralement qu’elle était de six coudées ou 3 mètres 15. — 7° Le mot hébreu, tsémed, rendu dans la Vulgate par júgerum, est employé deux fois6 comme mesure agraire ; il désigne l’étendue d’un champ qui peut être labourée en un jour par une paire de bœufs.
|
1 Doigt = |
|
|
|
|
0,0218 m |
|
4 |
1 Téfakh ou petit palme = |
|
|
|
0,0875 |
|
12 |
3 |
1 Zéreth ou grand palme = |
|
|
0,262 |
|
24 |
6 |
2 |
1 Coudée = |
|
0,525 |
|
144 |
36 |
12 |
6 |
1 Canne = |
3, 15 |
II. Mesures de longueur dans le Nouveau
Testament. — Les mesures particulières que nous trouvons employées dans
les Évangiles sont : une mesure spéciale aux Hébreux, le chemin du sabbat, et deux mesures, l’une grecque et
l’autre romaine, le stade et le mille. — 1° On appelait chemin du
sabbat7 la distance qu’il était légalement permis de
parcourir sans violer la loi du repos prescrit ce jour-là par la loi mosaïque.
Elle était de deux mille pas d’après les rabbins, environ 1392 mètres. — 2° Le stade8 valait 600 pieds grecs ou 625 pieds
romains, égaux à 125 pas romains, en mètres, 185. Huit stades faisaient un
mille. — 3° Le mille9 était une mesure
itinéraire d’origine romaine, ainsi nommée parce qu’elle correspondait à une
distance de mille pas. Elle équivalait à un peu plus de 1480 mètres. — 4° Les
Actes des Apôtres mentionnent la brasse, mesure
marine de 1,6 m.10
1° Les mesures de capacité étaient les mêmes pour les solides et pour les liquides, avec cette seule différence que l’unité de mesure des premiers s’appelait ῾êphâh et celle des seconds bath, mais leur contenu était identique. — 1° Le mot ῾êphâh signifie “mesure”. La Vulgate le rend tantôt par êphi11, tantôt par módius12, tantôt par ámphora13, tantôt par mensúra14. Les rabbins, qui ont pris comme terme de comparaison les œufs de poule dans les évaluations de leurs mesures de capacité, disent que l’éphas en contenait 432. Dans notre système, sa contenance est de 38 litres 88. — 2° Le mot bath signifie probablement aussi “mesure” : c’est celle qui, égale pour la quantité à l’῾êphâh, comme nous l’avons déjà remarqué, était destinée à mesurer les liquides15. Le bath n’est pas nommé avant l’époque des rois. La Vulgate le rend par batus16, laguncula17, cadus18, metreta19. Ce dernier mot est celui qui désigne l’amphore attique, c’est-à-dire, la mesure grecque qui correspond exactement à la capacité du bath, et qui est mentionnée en S. Jean20. L’amphore de Daniel21 est la même chose que le metréta ou le bath. — 3° La mesure de dix éphas s’appelait chômer ; elle reçut aussi plus tard le nom de cor. Chômer ou khômer veut dire monceau22 ; cor signifie vase rond. La Vulgate rend toujours le second mot par corus23 ; elle se sert aussi ordinairement de corus pour traduire chomer24 ; mais dans deux passages25, elle donne l’équivalent en mesures romaines, trente boisseaux. — 4° Le demi-chomer, valant cinq éphas, avait un nom particulier, léthek, Vulgate, corus dimidius. Il n’est nommé qu’une seule fois dans la Bible, dans Osée26. — 5° L’épha se subdivisait en plusieurs mesures de moindre dimension. Et d’abord en se’âh, dont la contenance était d’un tiers d’éphah27 ; le se’âh est mentionné deux fois dans les Évangiles28 ; notre texte latin traduit d’ordinaire satum, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament29. — 6° Le hin, d’origine égyptienne30, était la moitié du se’âh, le 6e de l’épha ou du bath. — 7° Le gomor, ῾ômer, Vulgate gomor, était la dixième partie de l’éphah31, d’où le nom de ῾issârôn ou dixième, Vulgate, décima pars, décima, qui désigne souvent cette mesure, dans le Pentateuque32. Il contenait la ration quotidienne de manne de chaque Israélite dans le désert33. Les rabbins disent qu’il tenait 45 œufs et demi. — 8° Le cab, cabus, « petit vase, coupe, » tiers du hin, 6e partie du se’âh, 18e de l’éphah34. — 9° Enfin le log, 72e partie de l’épha, 12e du hin35. S. Jérôme le traduit par sextarius. — 10° Dans le dernier chapitre de Daniel36, que nous n’avons plus qu’en grec, il est question d’une mesure persane appelée artabe ; elle équivalait à peu près au médimne attique, c’est-à-dire à 51 litres 79. — 11° L’Apocalypse37 emploie une mesure grecque, la seule étrangère que nous rencontrions dans le Nouveau Testament, le chœnix. On la regardait comme équivalente à la quantité de nourriture quotidienne d’un homme sobre. On évalue le chœnix à 1 litre 079. La Vulgate le traduit par bilibris.
2° En comparant entre elles les diverses mesures de capacité des Hébreux, on remarque qu’elles peuvent se diviser en deux systèmes, l’un décimal, l’autre duodécimal.
1°) Système décimal :
|
Chômer |
1 |
|
|
|
Bath ou épha |
10 |
1 |
|
|
Gomor |
100 |
10 |
1 |
2°) Système duodécimal :
|
Épha ou bath |
1 |
|
|
|
|
|
Se’âh |
3 |
1 |
|
|
|
|
Hin |
6 |
2 |
1 |
|
|
|
Cab |
18 |
6 |
3 |
1 |
|
|
Log |
72 |
24 |
12 |
4 |
1 |
3° Voici maintenant le tableau combiné de toutes les mesures et de leur valeur :
4 Ex. XXVIII, 16 ; XXXIX, 19 ; I Sam. (I Rois), XVII, 4 ; Ezech. XLIII, 13. La Vulgate a toujours traduit zéreth par palmus, ne distinguant pas explicitement cette mesure du téfakh, ou petit palme, mais elle a entendu par là le spithama ou grand palme, qui avait douze doigts, Vitruve, III, 1, Pour éviter la confusion, elle a rendu le petit palme téfakh, par quatre doigts, Ex. XXV, 25 ; XXXVII,12, et par tres unciæ, qui équivalent à quatre doigts, III Reg. VII, 26 ; cependant, dans les autres passages, elle a employé le mot palmus, et là il faut attribuer à ce mot la valeur du petit palme.
5 Ezech. XL, 5-8 ; XL1, 8 et suiv. ; XLII, 16-19 (Apoc. XXI, 15).
6 I Reg. XIV, 14 ; et Is. V, 10.
7 Act. I, 12.
8 Luc. XXIV, 13 ; Joan. VI, 19 ; Apoc. XXI, 16 (II Mach. XI, 5 ; XII, 10, 29).
9 Matth. V, 41.
10 Act, XXVII, 28. La brasse d’aujourd’hui est de 1,624 mètre ; celle des anciens était, on le voit, à peu près la même.
11 Ex. XVI, 36 ; Lev. V, 11 ; Ezech. XLV, 10, 11 etc.
12 Deut. XXV, 14 ; Is. V, 10, etc.
13 Zach. V, 6, 7, 8, 9.
14 Prov. XX, 10 ; Am. VIII, 5 ; Mich. VI, 10 ; dans ces derniers passages, S. Jérôme a rendu très exactement le sens du mot hébreu, parce qu’il est employé en effet dans le sens général de mesure.
15 Ezech. XLV, 11. Cf. III Reg. VII, 26, 38 ; I Esd. VII, 22, etc.
16 III Reg. VII, 26, 38 ; I Esd, VII, 22 ; Ez. XLV, 10, 11, 14.
17 Is, V, 10.
18 Dans l’Évangile de S. Luc. XVI, 6 (βάτους).
19 II Par, II, 10 ; IV, 5.
20 Joan. II, 6.
21 Dan. XIV, 2. L’amphora de la Vulgate, I Reg. I, 24, est employée pour rendre nêbel yaïn, une outre de vin, qu’on lit dans le texte hébreu ; Luc. XXII, 10, amphora correspond à κεράμιον, vase d’argile, vas fictile, urceus, ou bien lagéna, comme traduit notre version latine dans S. Marc. XIV, 13.
22 Ex. VIII, 14.
23 III Reg. IV, 32 ; V, 11 ; II Par, II, 10 ; XXVII, 5 ; Ez. XLV, 14.
24 Num. XI, 32 ; Ez. XLV, 11,13, 14, et Os. III, 2.
25 Lev. XXVII, 16, et Is, V, 10.
26 Os. III, 2.
27 Gen. XVIII, 6 ; I Reg. XXV, 18 ; III Reg. XVIII, 32 ; IV Reg. VII, 1, 16, 18 ; Is, XXVII, 8.
28 Matth. XIII, 33 ; Luc. XIII, 21. La forme βάτους vient du nom chaldéen de cette mesure, s’ath’a, parce qu’au temps de Notre-Seigneur on parlait syro-chaldéen en Palestine.
29 Excepté III Reg. XVIII, 32 (aratiuncula) ; IV Reg. VII, 1, 16, 18 (modius), et Is, XXVII, 8 (mensura).
30 Le mot hin est conservé dans la Vulgate, excepté Lev. XIX, 30, où il est rendu par sextarius, comme étant la 6e partie de l’épha.
31 Ex. XVI, 36.
32 Ex. XXIX, 40 ; Lev. XIV, 10, 21, etc.
33 Ex. XVI, 16.
34 Mentionné seulement IV Reg. VI, 25.
35 II en est question seulement dans le Lev. XIV, 10 et suiv., au sujet de la loi concernant la purification des lépreux.
36 Dan. XIV, 2.
37 Apoc. VI, 6.
Pendant la maladie d’Ézéchias, Isaïe, pour lui donner un signe de la guérison miraculeuse qu’il lui annonçait, fit rétrograder sur la demande du roi un cadran solaire de dix lignes, Is. XXXVIII. Ce miracle a donné lieu à des difficultés sur lesquelles il est nécessaire de dire quelques mots. « On doit recourir, pour expliquer ce miracle, aux mêmes hypothèses que nous avons proposées à l’occasion du miracle de Josué, car les deux faits présentent une grande analogie. Il y a cependant entre eux une différence qu’il convient de bien remarquer. Dans le cas de Josué, c’est le soleil même que la lettre du texte nous présente comme arrêté dans sa marche, ce qui suggère l’idée d’une perturbation importante dont les conséquences s’étendraient à toute la terre. Dans le cas présent, les textes nous parlent surtout de la rétrogradation de l’ombre sur le cadran, et si le soleil est une fois nommé, Is. XXXVIII, 8, il parait considéré moins en lui-même que dans l’effet produit par sa lumière sur le cadran. C’est là un phénomène très particulier, étroitement localisé et qui n’intéresse pas les lois générales de l’astronomie. De là résulte que la dérogation aux lois de la nature est moindre et plus facile à expliquer. Il n’est donc pas nécessaire d’admettre qu’il y ait eu réellement une rétrogradation du soleil dans sa marche diurne. Sans doute cela n’est pas impossible ; mais rien ne le donne à croire, et toutes choses s’expliquent plus facilement et plus naturellement d’une autre manière. — Il suffit d’admettre un phénomène local se réduisant au déplacement momentané d’une ombre portée. Cela suppose une déviation miraculeuse des rayons lumineux qui éclairent le cadran, et cette déviation se peut expliquer, comme pour le miracle de Josué, soit par une action directe de la puissance divine sur la propagation des rayons, soit par l’interposition de corps réfracteurs ou réflecteurs dont la nature demeure indéterminée. Quoi de difficile en tout cela, quand Dieu daigne mettre la main à l’œuvre ? Lui est-il plus difficile de dévier un rayon de lumière que de retenir le cours d’un fleuve ou de guérir subitement une maladie ? Et est-il nécessaire que le mécanisme de l’effet produit nous soit entièrement connu pour que nous croyions, sur bonnes preuves, à la possibilité et à la vérité de l’intervention divine ? » (M. Boisbourdin.)
Cette seconde partie date de la fin de la vie d’Isaïe. Elle ne forme qu’un tout, régulièrement divisé, dans lequel le prophète prédit aux Juifs leur délivrance de la captivité de Babylone et le règne futur du Messie. C’est le livre des consolations, comme l’annoncent les mots par lesquels il s’ouvre et qui en sont comme le titre et le résumé : Consolez-vous, mon peuple, consolez-vous, dit votre Dieu, XL, 1. Il se partage en trois séries de discours, symétriquement divisés par groupes de neuf, 3 X 3. — Première section : XL-XLVIII. Discours : 1° XL ; 2° XLI ; 3° XIII-XLLII, 13 ; 4° XLIII, 14-XLIV, 5 ; 5° XLIV, 6-23 ; 6° XLIV, 24-XLV ; 7° XLVI ; 8° XLVII ; 9° XLVIII. — Seconde section : XLIX-LVII. Discours : 1° XLIX ; 2° L ; 3° LI ; 4° LII, 1-12 ; 5° LII, 13-LIII ; 6° LIV ; 7° LV ; 8° LVI, 1-8 ; 9° LVI, 9-LVII. — Troisième section : LVIII-LXVI. Discours : 1° LVIII ; 2° LIX ; 3° LX ; 4° LXI ; 5° LXII ; 6° LXIII, 1-6 ; 7° LXIII, 7-LXIV ; 8° LXV ; 9° LXVI. — On peut regarder comme certaines les subdivisions de la seconde et de la troisième sections ; au milieu de la première, il n’est pas aussi aisé de voir où commencent et où finissent les discours particuliers. La fin de la première et de la seconde sections est marquée par le même verset final : Il n’y a point de paix pour les impies, dit le Seigneur, XLVIII, 22 ; LVII, 21 ; celle de la troisième reproduit la même pensée, en termes plus énergiques : Leur ver ne mourra pas et leur feu ne s’éteindra pas, LXVI, 24.
Voici quel est le sujet de la seconde partie. « Les prophéties contenues dans ses trois sections ne sont que des variations d’un même thème, mais elles ont cependant chacune une pensée fondamentale particulière et une modalité propre, annoncée du reste dès les premiers mots. Elles ont pour sujet principal de consoler le peuple et de l’exhorter à la pénitence, en lui annonçant le salut qui est proche. De plus, dans chaque section, le Prophète établit un contraste et une sorte d’antithèse qu’il met au premier plan ; dans la première, XL-XLVIII, c’est la lutte de Jéhovah et des idoles, d’Israël et des païens ; dans la seconde, XLIX-LXII, c’est l’opposition entre les souffrances du serviteur de Jéhovah [le Messie] dans le présent et sa glorification dans l’avenir ; dans la troisième, c’est la contradiction d’Israël lui-même, hypocrite, impie, apostat d’une part, et de l’autre, fidèle, malheureux, persécuté. La première section annonce la délivrance de la captivité de Babylone ; cette délivrance est l’accomplissement des prophéties, la honte et la ruine des idoles et de leurs adorateurs. La seconde nous montre les humiliations profondes du serviteur de Jéhovah devenant la source de sa gloire et élevant en même temps Israël lui-même à la hauteur de sa vocation divine. Enfin ce n’est pas sans raison que Hahn a trouvé le résumé des idées principales des trois sections dans les trois propositions du vers. 2 du ch. XL : Sa malice est arrivée au terme, son iniquité a été pardonnée, elle a reçu de la main du Seigneur une double peine pour tous ses péchés. La fin de la captivité de Babylone est, en effet, l’idée-mère de la première section ; l’expiation du péché par le sacrifice volontaire du serviteur de Jéhovah, l’idée-mère de la seconde, et la gloire, surpassant de beaucoup les souffrances expiatrices, l’idée-mère de la troisième. La promesse s’élève ainsi par degrés dans les discours 3×9, jusqu’à ce qu’elle atteigne enfin son apogée, LXV-LXVI, où le temps et l’éternité se confondent ensemble. » (Delitzsch.)
La première section annonce donc la délivrance des Juifs captifs par Cyrus. « Mais ce roi terrestre ne fera que peu de choses, comparativement à ce qu’il y a à faire : un autre joug, bien plus pénible que celui de Babylone, pèse sur Israël et sur l’humanité entière, c’est le joug du péché. Un libérateur paraitra, plus puissant que Cyrus et que tous les rois de la terre, il délivrera son peuple de la servitude du péché et fondera un royaume dans lequel entreront tous ceux qui voudront le servir et reconnaitre son empire. Ce ne sera qu’une partie du peuple, au reste, qui retournera à Jéhovah et sera une semence sainte, Isaías, X, 22 ; VI, 13. C’est à ce faible reste que Jéhovah adresse d’une manière toute particulière ses prophéties sur l’œuvre qu’accomplira son Serviteur… Les ch. XL-XLVIII mettent en lumière la majesté de Jéhovah qui se manifeste par la délivrance matérielle de son peuple ; mais déjà apparaissent les promesses de la délivrance spirituelle. La personne du Serviteur de Dieu forme le centre et le point culminant dans les ch. XLIX-LVII. Enfin nous contemplons les résultats de l’œuvre du Serviteur et la félicité de ses élus, LVIII-LXVI. » (Schmitz.)
« Relativement au langage, il n’y a rien de plus achevé, de plus lumineux dans tout l’Ancien Testament que cette trilogie de discours d’Isaïe. Dans les ch. I-XXXIX, le langage du prophète est généralement plus concis, plus lapidaire, plus plastique, quoique déjà, là aussi, son style sache prendre toutes sortes de couleurs. Mais ici, XL-LXVI, où il n’est plus sur le terrain du présent, où, au contraire, il est ravi dans un lointain avenir comme dans sa patrie, le langage lui-même prend en quelque sorte le caractère de l’idéal et je ne sais quoi d’éthéré ; il est devenu semblable à un large fleuve, aux eaux brillantes et limpides, qui nous transporte comme dans l’éternité, sur ses flots majestueux et en même temps doux et clairs. Dans deux passages seulement, il est dur, trouble, lourd, c’est LIII et LVI, 9-LVII, 11a. Le premier reflète le sentiment de la tristesse, le second celui de la colère. Partout, du reste, se manifeste l’influence du sujet traité et des sentiments qu’il produit. Dans LXIII, 7, le prophète prend le ton du Tefilla (ou de la prière) liturgique ; dans LXIII, 19b-LXIV, 4, la tristesse entrave le cours de sa parole ; dans LXIV, 5, comme dans Jer. III, 25, on entend le ton du Viddui (la confession) liturgique. » (Delitzsch.)
Relativement à son contenu, la seconde partie d’Isaïe est également incomparable. Elle commence par une prophétie, XL, 3-4, qui met dans la bouche de saint Jean-Baptiste le sujet de sa prédication ; elle se termine par la prophétie de la création d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre, comme la dernière page de l’Apocalypse qui, dans le Nouveau Testament lui-même, n’a pu aller au delà ; au milieu, LII, 13-LIII, elle annonce les souffrances et la gloire de Jésus-Christ avec autant de clarté que si le prophète avait assisté à sa mort au pied de la croix et avait été témoin de sa résurrection. Ainsi, en commençant, il se place aux premières années du Nouveau Testament, comme les Évangélistes eux-mêmes ; il décrit ensuite la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme si c’étaient des faits accomplis et avec la même clarté que saint Paul dans ses Épitres ; enfin, sortant de ce monde, il pénètre dans le ciel, comme l’Apocalypse de saint Jean, de sorte que, sans sortir des barrières où l’enferme l’Ancien Testament, il réunit, dans sa seule personne, l’évangéliste, l’apôtre et l’écrivain apocalyptique. Les souffrances du Messie, qu’annoncent plusieurs psaumes de David, sont ici prédites plus expressément encore. Dans Isaïe, il ne nous apparait plus seulement comme roi et fils de David ; c’est le serviteur de Dieu, de Jéhovah, qui est tout à la fois roi et pontife, parce que, persécuté à mort par les siens, il s’immole volontairement, et Dieu le récompense de son sacrifice en le glorifiant et le rendant le sauveur de son peuple et des Gentils. Isaïe a légué à Israël ses sublimes discours pour qu’ils pussent le consoler au milieu de la captivité de Babylone. On les a comparés aux derniers discours que prononça Moïse dans la plaine de Moab et qui nous ont été conservés dans le Deutéronome ; bien mieux encore, aux discours de Notre-Seigneur, après la Cène, que nous lisons dans l’Évangile de saint Jean. Par leur élévation, leur profondeur, ils comptent en effet parmi les plus belles pages de nos Saintes Écritures.
« Cette prophétie est une des plus difficiles de l’Ancien Testament, dit Calmet. Il y en a très peu qui aient plus partagé les anciens et les nouveaux interprètes. » Voici l’explication la plus vraisemblable et la plus communément admise aujourd’hui. — 1° Gog, roi de Rôsch (Vulgate : chef), de Mosoch et de Thubal, dans la terre de Magog, est un chef Scythe. Rôsch désigne une peuplade scythe qui habitait les environs du Taurus ; Mosoch et Thubal, les Mosques et les Tibaréniens des auteurs classiques. Gog réunit ses soldats, et, sur l’ordre de Dieu, les conduit du septentrion contre la Palestine ; il a dans son armée des habitants de presque tout le monde ancien : des Perses, des Éthiopiens et des Lybiens, des fils de Gomer et de Thogorma, c’est-à-dire des Cimmériens et des Arméniens, XXXVIII, 1-9. — 2° Son but est de piller et de dévaster la Terre Sainte redevenue prospère, 10-16. — 3° Mais cette invasion de barbares ne servira qu’à apprendre aux païens quelle est la puissance du vrai Dieu, car il anéantira la formidable armée de Gog, 17-23. — 4° Elle périra sur les montagnes d’Israël, XXXIX, 1-8. — 5° Il faudra aux habitants sept années pour bruler les armes des morts et sept mois pour ensevelir leurs cadavres, pendant que les oiseaux de proie se rassasieront de leur chair, 9-20. — 6° Toutes les nations apprendront ainsi que si Dieu a puni son peuple et l’a livré aux païens, parce qu’il avait péché, il s’est maintenant réconcilié avec lui et ne l’abandonnera plus, 21-29. — Gog est la figure des ennemis et des persécuteurs de l’Église, Apoc. XX, 7.
Dans les dernières années du VIIe siècle avant J.-C, les Scythes avaient fait dans l’Asie occidentale une invasion formidable qui avait rendu leur nom redouté et exécré. Chassés des montagnes du Caucase, qu’ils habitaient, par les Massagètes, ils étaient descendus dans l’Asie Mineure ; armés de l’arc et montés sur des chevaux, comme nous les représente Ezech. XXXIX, 3, et XXXVIII, 15, ils avaient pris Sardes ; puis se tournant vers la Médie, ils défirent Cyaxare, roi de ce pays ; de là, ils se dirigèrent vers l’Égypte. Psammétique parvint à les éloigner, à force de présents ; revenant donc sur leurs pas, ils pillèrent le temple d’Ascalon ; mais ils furent enfin battus et détruits, non pas cependant sans laisser leur nom après eux comme un synonyme de terreur et d’épouvante. La tradition rattache le nom de Scythopolis, l’ancienne Bethsan, à la scène de leur désastre. Le souvenir de leurs ravages et de leurs cruautés était encore récent et présent à toutes les mémoires quand écrivait Ézéchiel ; voilà pourquoi Dieu lui inspira de prendre les Scythes comme l’emblème de la violence contre le peuple de Dieu, et de montrer dans leur défaite le signe prophétique de la défaite de tous les ennemis de son nom.
1° La monnaie frappée était inconnue aux Hébreux avant
l’époque des Macchabées. La plupart des échanges se faisaient en nature,
c’est-à-dire qu’on donnait un objet à la place d’un autre, une brebis, par
exemple, en échange d’une étoffe, des sandales pour un vase de liqueur1.
Les métaux précieux, dont on se servait aussi, n’étaient pas marqués d’une
empreinte, mais simplement divisés en lingots, barres, anneaux ou fragments
d’un poids déterminé ; s’ils pesaient un talent, un sicle, etc., on les
appelait talent, sicle, etc., de sorte que le système monétaire correspondait
exactement à celui des poids et que le nom de ces derniers était aussi celui
des monnaies, comme on peut voir par le tableau suivant, dans lequel leur
valeur est évaluée d’une manière approximative.2
|
|
Or. |
Argent. |
|
Talent = |
131 850 Fr. |
8 500 Fr. |
|
Mine = |
2 200 |
141 |
|
Sicle = |
43, 50 |
2,83 |
|
Béqah = |
21, 75 |
1,42 |
|
Gérah (obole) = |
2,17 |
0,14 |
Le sicle est déjà mentionné dans le Pentateuque3 de même que le béqah ou demi-sicle4, le gérah ou vingtième de sicle5, et le talent6. Les Hébreux, dans tous les échanges, pesaient les métaux précieux pour en déterminer exactement la valeur, de la même manière que le faisaient les Égyptiens, ainsi que nous l’apprennent les monuments figurés7. — La Genèse, Josué et Job8, mentionnent une monnaie particulière appelée qesitâh, que la Vulgate a traduit par agneau ou brebis ; on ignore quel en était le poids et par conséquent la valeur9.
Fig. 3. — MARCHÉ ÉGYPTIEN, DANS LEQUEL LES VENTES ET LES ACHATS SE FONT PAR L’ÉCHANGE D’OBJETS DIVERS.
1 Voir Figure 3, un
marché égyptien, peint sur les piliers d’un tombeau de la Ve
dynastie (antérieur à l’époque d’Abraham). Sur le registre supérieur, dans la
première scène à droite, un marchand est assis devant un grand panier, place
sur un support et contenant trois vases. Les hiéroglyphes nous font connaitre
la conversation du marchand et de l’acheteur. « Voici pour toi de la
liqueur sat douce, » dit le premier au second. Celui-ci, qui tient de la main
droite une paire de sandales, lui répond : « Voici pour toi des sandales
solides. » Un second acheteur s’avance, portant à la main droite un petit
coffret. — Dans la scène suivante, une femme marchande des poissons à un homme
qui prépare un poisson ; une nasse placée devant lui contient quatre
autres poissons. L’acheteuse porte sur son épaule un coffret carré qui renferme
ce qu’elle va donner en échange au marchand. — Sur le registre inférieur, à
droite, deux acheteurs sont debout devant un grand panier rempli de légumes. « Donne
voir, donne l’équivalent, » dit le vendeur au premier acheteur qui tient
sous le bras gauche une sacoche et qui en échange présente de la main droite au
marchand un chapelet de verroterie ; il a un autre fil de verroterie dans
la main gauche. Le second acheteur achète les légumes en échange d’un éventail
qu’il tend de la main droite ; dans la main gauche, il a un attise-feu. —
Plus loin, dans la scène suivante, nous voyons deux hommes debout en
pourparlers : l’un tient trois hameçons de la main droite. La femme qui
suit porte un coffret sur l’épaule et est en train de faire des achats à un
marchand d’habits.
2 Une pièce d’argent de 1 franc pèse 5 grammes ; une pièce d’or de 5 fr., 1 gr. 6129 ; de 10 fr., 3 gr. 2268 ; de 20 fr., 6 gr. 4516 ; une pièce de cuivre de 0,05 cent, pèse 5 grammes.
3 Gen. XX, 16.
4 Ex. XXX, 13.
5 Ex. XXX, 13.
7 Voir Figure 4. Le monument est frustre.
8 Gen. XXXIII, 10 ; Jos. XXIV, 32 ; Job. XLII, 11.
9 On a souvent supposé, à cause de la traduction de la Vulgate, que le qesitâh portait l’empreinte d’un agneau, mais comme la monnaie frappée était complètement inconnue à l’époque de Jacob, cette supposition est inadmissible. Cependant il est possible que le qesitâh eût la forme d’un agneau ou fût équivalent à un poids figuré par un agneau, analogue aux poids assyrien » « égyptiens, ayant la forme de lions, de bœufs, de canards, etc. On explique aussi le qesitâh par la coutume de plusieurs peuples de l’antiquité de prendre une brebis comme une sorte d’étalon monétaire.
Fig. 4. — ÉGYPTIENS PESANT DES MÉTAUX PRÉCIEUX, COUPÉS EN FORME D’ANNEAUX, DANS UNE BALANCE, AVEC DES POIDS FIGURANT UNE ANTILOPE
COUCHÉE (THÈBES).
2° Après la captivité et avant l’établissement de la dynastie hasmonéenne, les Juifs comptaient par dariques, célèbres monnaies perses, en or pur, portant d’un côté l’effigie du roi tenant une javeline ou un sceptre dans sa main droite et un arc dans la gauche ; sur le revers est gravé une sorte de carré irrégulier10.
Fig. 5. — DARIQUE. OR11
Le nom hébreu de ces pièces est darkemôn et ’adarkemôn, et il est traduit dans la Vulgate par solidus, drachma12. L’évaluation de la darique est incertaine. Paucton l’estime 25 Fr.13
10 Voir Figure 5. Le roi, agenouillé, porte la
couronne ; il est vêtu de la longue robe perse ; sa barbe et ses
cheveux sont longs. — On attribue à Darius l’introduction de la monnaie en Perse,
d’où le nom de darique qui lui fut donné. Le type des dariques fut le même,
à peu de choses près, pendant toute la durée du royaume perse.
11 Les monnaies que nous donnons ici ont été dessinées
par M. l’abbé Douillard et gravées par M. Gusman, d’après les plus beaux
spécimens du cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale.
12 I Esd., Il, 69 ; VIII, 27 ; II Esd. VII, 70, 71, 72 ; I Par. XXIX, 7. Dans ce dernier passage, le mot darique est employé
par anticipation, puisqu'il s'agit du temps de David ; mais Esdras, qui
est probablement l'auteur des Paralipomènes, se sert du mot qui avait cours à
son époque, comme nous exprimons quelquefois aujourd'hui en francs la valeur
des monnaies anciennes ; comme l'a fait la Vulgate elle-même pour les
dariques, qu'elle a rendues par « drachmes, » II Esd. VII,
70, 71,72.
13 La darique était la 60e partie de la mine
babylonienne et pesait 8 gr. 40.
3° L’an 140 avant J.-C., Simon Macchabée reçut d’Antiochus VII Sidètes, roi de Syrie, le droit formel de battre monnaie14. Nous possédons de Simon Macchabée et de plusieurs des princes qui gouvernèrent après lui la Judée, des sicles et des demi-sicles d’argent ou de bronze. Le poids moyen du sicle est de 14 gr. 2 ; celui du demi-sicle de 7 gr. 1. Ils portent d’ordinaire, d’un côté, une inscription en anciens caractères hébreux, sicle d’Israël ou demi-sicle, avec l’indication de la date, et sur le revers : Jérusalem la sainte, ou : l’affranchissement de Sion. En observation de la loi, aucune de ces monnaies ne porte d’effigie humaine, mais sur les deux faces sont représentés, tantôt un vase et une verge fleurie, tantôt un palmier, des épis, une grappe de raisin, etc. Les dernières monnaies juives sont celles du roi Agrippa et de Barcochébas. Leur valeur était la même que celle que nous avons indiquée plus haut, au 1°. Après la ruine de Jérusalem, les Romains firent frapper des monnaies représentant au revers la Judée captive sous la forme d’une femme assise sous un palmier.
Fig. 6. — SICLE, ARGENT. DE SIMON MACHABÉE15.
Fig. 7. — DEMI-SICLE, ARGENT. DE SIMON MACHABÉE16.
Fig. 8. — GRAND BRONZE. DE SIMON MACHABÉE17.
Fig. 9. — PETIT BRONZE. DE SIMON MACHABÉE18.
Fig. 10. — MOYEN BRONZE. JUDEA CAPTA19.
13 I Mach. XV, 6.
14 Une coupe est représentée sur le sicle. On lit autour, en vieux caractères
hébreux : Schéqel Israël, « sicle d’Israël. Au-dessus de la coupe est
la lettre aleph, employée numériquement, désignant la première année où Simon Machabée
battit monnaie. Cette année est probablement l’an 141-140 av. J.-C. — R.
(Revers). Rameau avec trois fleurs, représentant peut-être la verge d’Aaron.
Ierouschalem qedoschah, « Jérusalem sainte. »
16 Une coupe, ornée de pierreries. Khatzi ha-schéqel, « demi-sicle. »
Au-dessus de la coupe, schenath b, « année 2 » de Simon Machabée,
c’est-à-dire 140-139 avant J.-C. — Revers : Verge fleurie.
Ierouschaleim ha-qedoschah, « Jérusalem la sainte. »
17 Deux faisceaux de branches avec feuilles appelés loulab, entre lesquels est un
citron appelé éthrog. Schenath ῾arba’ khatsi, « année
quatrième. Demi-sicle. » — Revers : Un palmier portant des dattes. De
chaque côté, une corbeille remplie de fruits. Lig’ullath Tsion, « l’affranchissement
de Sion. » Le loulab, composé de branches de palmier, de saule et de
myrte, représente avec l’éthrog, citron, les rameaux que les Israélites devaient
porter à la fête des Tabernacles. Lev. XXII, 40[?] ; cf. II Esd. VIII, 15. Les corbeilles
remplies de fruits figurent sans doute les offrandes des prémices. Deut. XXIV, 2 ; Jer. VI, 9.
18 Une coupe. — Revers : Lig’ullath Tsion, « l’affranchissement
de Sion. » — R/. Faisceaux de branches avec feuilles
(loulab) entre deux citrons (ethrog). Schenath’arba’. « année quatrième. »
19 Tête laurée de Titus à droite. T. CÆS. IMP. AVG. F. TR. P. COS. VI.
CENSOR. — Revers : La Judée en pleurs, assise sur des boucliers auprès
d’un palmier ; derrière, une cuirasse, un bouclier, un casque et un étendard. IVDÆA CAPTA.
En exergue S. C. (Senatus consulto.) (77 ou 78 de notre ère).
Du temps de Notre-Seigneur, on se servait surtout, en Palestine, des monnaies grecques et romaines. Le Nouveau Testament mentionne une espèce de monnaie juive, cinq espèces de monnaies grecques et quatre espèces de monnaies romaines.
I. Monnaie juive.
Argenteus, ou monnaie d’argent20, désigne le sicle.
II. Monnaies grecques.
Elles sont toutes d’argent. — 1° La drachme21, monnaie d’argent, équivalait au denier romain ; elle était la 6,000e partie du talent attique, la 100e partie de la mine, et se divisait en 6 oboles. Au siècle de Périclès, elle pesait, d’après Letronne, 4 gr. 363 et valait environ 0,92 cent. ; après Alexandre le Grand, elle descendit jusqu’à 4 gr. 103 ou 0,87 cent.
Fig. 11. — DRACHME. ARGENT22
20 Matth. XXVI, 15 ; XXVII,
3 et suiv.
21 Luc. XV, 8, 9.
22 Tête de Pallas casquée, à droite. — Revers :
Chouette sur une amphore dans une couronne d’olivier. À gauche, une ancre. AΘE. (Des Athéniens). TIMA. NIK. APXE (Timqrque
Nicagoras, magistrat monétaire).
2° Le didrachme23 valait deux drachmes ou un demi-sicle ou un demi-statère.
Fig. 12. —
DIDRACHME. ARGENT.
23 Matth. XVII, 23.
3° Le statère24, appelé aussi tétradrachme, parce qu’il valait quatre drachmes, était équivalent au sicle. Il portait d’un côté la tête de Minerve, et de l’autre, la chouette, attribut de cette déesse.
Fig. 13. — STATÈRE OU TÉTRADRACHME. ARGENT25
24 Matth. XVII, 26.
25 Tête de Pallas casquée, à droite. — Revers : Chouette sur une amphore portant la lettre de série A. Dans le champ, deux monogrammes ; ils désignent le nom de magistrats monétaires qu’il est impossible de restituer. Le tout dans une couronne d’olivier. Tétradrachme postérieur à Alexandre le Grand.
Fig. 14. — STATÈRE. OR26
26 Tête de Pallas casquée, à droite. — Revers : Chouette. Deux feuilles d’olivier et un croissant, à gauche. À droite, AΘE.
4° La mine, mna27, valait, chez les Grecs, cent drachmes.
27 Luc. XIX,
13 et suiv.
5° Le talent, talentum28, τάλαντον, était d’or ou d’argent. Son poids et sa valeur ont beaucoup varié selon les temps et les lieux. Le talent d’or valait dix talents d’argent. Le talent attique d’argent était de 70 mines ou 6,000 drachmes, c’est-à-dire de 26 kgr. 107 ou 5,560 Fr. environ ; celui de Corinthe ou d’Egine était de 100 mines.
28 Matth. XVIII, 24 ; XXV, 15 et suiv. ; cf. Apoc. XVI,
21.
III. Monnaies romaines.
1° Le denier, en latin denarius, pièce d’argent ainsi appelée parce qu’elle
avait primitivement la valeur de dix as ; plus tard elle en valut seize.
Elle est souvent mentionnée par les Évangélistes29. Son poids était
le même que celui de la drachme ou quart de sicle. Du temps de Notre-Seigneur,
le denier équivalait à 0,78 cent, environ. Cette monnaie représentait d’abord,
d’un côté la déesse Rome ou la Victoire, et de l’autre un char, attelé de
quatre chevaux ; sous l’empire, on la frappa à l’effigie de César30.
Elle constituait la solde quotidienne du soldat romain, au rapport de Tacite,
comme la drachme celle du soldat athénien, au rapport de Thucydide. C’était
également la paie qu’on donnait pour leur journée aux ouvriers qui
travaillaient à la vigne, d’après la parabole évangélique31. C’était
aussi enfin la taxe que chaque Juif était tenu de payer aux Romains comme
capitation, et que saint Matthieu appelle numisma
census32.
29 Matth. XVIII, 28 ; XX, 2, 9, 10, 13 ; XXII, 19 ; Marc. VI, 37 ; XII, 15 ; XIV, 5 ; Luc. VII, 41 ; X, 35 ; XX, 24 ; Jean., VI, 7 ; XII,
5 ; Apoc. VI,
6.
30 Matth. XXII, 19-24.
31 Matth. XX, 2 et suiv.
32 Matth. XXII, 19 ; cf. Marc. II,
15 ;
Luc. XX,
24.
Fig. 15. — DENIER DE L. ANTESTIUS GRACULUS. ARGENT33
33 Tête de la déesse Rome à
droite, avec le casque ailé. GRAG (Graoulus). — Revers : Jupiter dans un quadrige au galop à
droite, tenant un sceptre et lançant la foudre. — L. ANTES. — ROMA (Lucius
Antestius — Roma). Vers 124 avant J.-C.
Fig. 16. — DENIER D’AUGUSTE. ARGENT34
34 Tête laurée d’Auguste à
droite. CÆSARI AVGVSTO. — Revers : Quadrige orné de la Victoire, marchant
au pas à droite et surmonté de l’image d’un autre quadrige. À l’exergue :
SPQR (Senatus populusque Romanus).
2° L’assarius, diminutif d’as35, était une monnaie de cuivre, présentant, de face, la figure de Janus, puis, plus tard, celle de César, et, sur le revers, une proue de navire. Il valait de 6 à 7 centimes. La Vulgate rend άσσάρτον36, par as et deux assarii, par dipondium37.
35 Matth. X,
29 ;
Luc. XII,
6.
36 Matth. X, 29.
37 Luc. XII,
6. Du temps de Notre-Seigneur, un as
représentait en Palestine le prix de deux passereaux, Matth. X,
29. Pour deux as (de douze à treize
centimes), on avait cinq passereaux, Luc. XII, 6.
Fig. 17. — AS DE FABIUS BUTEO. BRONZE38.
38 Tête laurée de Janus. — Revers : Proue de navire
à droite, sur laquelle est posé l’oiseau appelé
buteo (héron ou cigogne). FABI. ROMA.
Vers 89 avant J.-C.
Fig. 18. — ASSARIUS. BRONZE.39
39 Tête radiée d’Auguste à gauche. DIWS. AVGVSTVS.
PATER. — Revers : Un autel. IMP. T. VESP. AVG. REST. Imperator Titus Vespasianus
Augustus restituit. Dans le
champ : S. C. (Senatus consulto). À l’exergue : PROVIDENT (NT est en monogramme).
3° Le quadrans40, était un quart d’as en cuivre et valait un peu moins de deux centimes.
40 Matth. V, 26 ; Marc. XII, 42.
Fig. 19. — QUADRANS DE SERVILIUS. BRONZE41.
41 Tête d’Hercule, coiffé de la peau de lion, à
droite ; derrière, trois points. — Revers : Proue de navire, sur
laquelle on lit : SERVILIVS ; en haut, deux épis. — Caius Servilius
ou Serveilius fut magistrat monétaire vers 123 avant J.-C.
4° Le minutum, λεπτόν42, monnaie de cuivre, était la moitié du quadrans, comme l’explique saint Marc43, le huitième de l’as, un peu moins de 1 centime.
42 Luc. XII, 59 ; XXI, 2 ; Marc. XII, 42.
43 Marc. XII, 42.
Fig. 20. — LA PLUS PETITE MONNAIE DE BRONZE SOUS AUGUSTE44.
44 Une enclume. MESSALA. APRONIVS. III. VIR. —
Revers : GALVS. SISENNA. A. A. A. F F. Dans le champ : S. C. —
Cornélius Sisenna, vers l’an 12 avant J.-C., fit partie d’un collège monétaire
avec Volusus Valerius Messalla, Apronius et Galus. III VIR signifie triumvir ; A. A. A. F. F.,
œre argento auro flando feriundo ; S. C. senatus consulto.
&noadnt
NOTES COMPLÉMENTAIRES (NOUVEAU TESTAMENT)
Pour rendre compte des différences qu’on remarque entre ces deux généalogies, il y a deux sentiments : Le premier tient que S. Matthieu a donné la généalogie de S. Joseph, et S. Luc celle de la sainte Vierge. Cette hypothèse semble plausible pour deux raisons :
1° Il était naturel que S. Matthieu, écrivant pour les Juifs, fît voir que Jésus était l’héritier de David, et qu’il prouvât, par sa généalogie légale ou paternelle, qu’on ne pouvait contester au Christ le droit de succession. Il convenait également que S. Luc, qui écrivait pour les Gentils, considérât le Sauveur comme né de la femme, et qu’il exposât sa généalogie réelle. Après avoir annoncé si expressément que Jésus n’avait pas de père sur terre, il serait étonnant qu’il eût donné sa généalogie légale par son père putatif. Ajoutez que, dans le cas où il aurait voulu la citer, on ne verrait pas pourquoi il n’aurait pas suivi la même ligne que S. Matthieu.
2° Les termes employés par S. Luc : Jésus était, comme l’on croyait, fils de Joseph, qui le fut d’Héli, se prêtent sans effort à cette explication, soit qu’on traduise simplement : Jésus passait pour être fils de Joseph, lequel l’était d’Héli, en rapportant à Joseph le relatif qui, soit qu’on entende : Jésus était regardé comme né de Joseph, mais il l’était d’Héli, en rapportant le pronom relatif au mot Jésus énoncé précédemment. — Dans le premier cas, il faut admettre que Joseph tient la place de Marie son épouse ou qu’il est nommé comme gendre d’Héli, mais on sait que tel était l’usage chez les Hébreux ; et S. Luc n’avait pas à craindre de tromper personne par cette substitution, les chrétiens étant avertis par S. Matthieu que le véritable père de S. Joseph était Jacob, et la tradition assignant au père de la sainte Vierge précisément le nom de Joachim, synonyme d’Éliachim ou d’Héli. — Dans le second cas, les termes de la traduction écartent la difficulté et l’empêchent même de s’offrir à l’esprit. Il est vrai que ces mots : Qui fut d’Héli, ne doivent pas s’entendre d’une filiation stricte, mais d’une simple descendance, puisque Héli serait l’aïeul de Notre Seigneur et non son père proprement dit ; mais c’est le sens qu’on donne à ces mots dans une foule d’endroits de l’Écriture et le seul qui s’offre ici, si l’on continue de rapporter à Jésus les mots qui suivent : Qui fut de Mathat, qui fut de Dieu. Il est vrai encore que cette traduction aurait peine à s’accorder avec le grec, si l’on s’attachait au texte reçu ; mais l’accord devient facile si l’on admet une leçon qui ne parait pas avoir moins d’autorité, celle des manuscrits du Vatican et du Sinaï, les plus anciens de tous.
Un second sentiment, très ancien et très commun chez les Docteurs jusqu’au quinzième siècle, regarde les deux généalogies comme propres à S. Joseph, et elle en explique les différences par un usage juif, celui du lévirat. En Judée, quand une femme restait veuve et sans enfant, elle devenait l’épouse de son beau-frère ou d’un de ses proches, et les enfants qui naissaient de cette union prenaient le nom du premier mari défunt ; ils étaient censés les siens. De là pour un grand nombre la pluralité des généalogies, les lignes fictives ou légales s’adjoignant aux lignes naturelles ou à la descendance réelle. De là pour S. Joseph une double filiation, Jacob étant son père naturel indiqué par S. Matthieu, et Héli, frère utérin de Jacob et mort avant lui sans enfant, étant son père légal, désigné par S. Luc. De même pour Salathiel. (L. Bacuez.)
Bethléem, « la maison de pain », ainsi appelée sans doute à cause de la fertilité de son territoire, était la patrie de David et de Notre Seigneur Jésus-Christ. Elle appartenait à la tribu de Juda et avait été surnommée Ephrata, « la fertile », pour la distinguer d’une autre Bethléem de la tribu de Zabulon.
« Bethléem est bâtie [à 822 mètres d’altitude] sur un monticule qui domine une longue vallée. Cette vallée s’étend de l’est à l’ouest : la colline du midi est couverte d’oliviers clairsemés sur un terrain rougeâtre, hérissé de cailloux ; la colline du nord porte des figuiers sur un sol semblable à celui de l’autre colline. » (Chateaubriand.)
« La colline occidentale a des pentes abruptes du côté du midi et beaucoup plus douces vers le nord ; vers le couchant, elle n’est presque plus escarpée, et vers l’orient, la pente est plus douce encore. La seconde colline, qui lui fait face de ce côté, est moins haute, mais plus large. La ville est ainsi partagée en deux parties qui se répondent, et comme sur trois points elle est environnée de vallées, elle offre aux regards un horizon très étendu et très varié. Jadis entourée de murs, elle est actuellement ouverte, et c’est plutôt un grand village qu’une ville proprement dite. Sa longueur de l’ouest à l’est atteint à peine neuf cents pas, et sa largeur en moyenne ne dépasse point deux cent cinquante pas. » (V. Guérin.)
Ainsi élevée sur sa double colline, avec les champs de blé et les vignobles qui s’étendent à ses pieds, Bethléem est comme le type du village juif. Le puits, dont David désirait boire de l’eau, est non loin de la porte. À l’est sont les collines sauvages où paissaient les troupeaux de David, du prophète Amos et des autres pasteurs bethléhémite.
Le climat de Bethléem est assez froid, à peu près identique à celui de Jérusalem. La neige y tombe de temps en temps en hiver, mais elle fond vite. L’air y est assez vif et le vent y souffle quelquefois avec violence.
L’église de la Nativité s’élève aujourd’hui au-dessus de la grotte où est né Jésus-Christ. Elle est située dans la partie septentrionale de la colline orientale, au-dessus de la vallée des caroubiers. C’est dans la crypte de l’église, sous le chœur, qu’est la grotte de la Nativité. Elle a 12 mètres 40 de longueur de l’est à l’ouest sur 3 m. 90 de largeur et 3 de hauteur, et servait d’étable au temps de Notre Seigneur. Les parois du rocher, ainsi que le pavé, disparaissent actuellement sous un revêtement de marbre. Dans une petite chapelle, à l’est, on voit sous l’autel une étoile d’argent avec cette inscription : Hic de Vírgine Maria Jésus Christus natus est. Tout auprès, du côté du midi, est la chapelle de la Crèche, où l’on descend par trois marches. On y voit une crèche de marbre avec un enfant Jésus en cire. La véritable crèche, ou plutôt les fragments qui en restent, ont été transportés à Rome en 642 et sont conservés aujourd’hui dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure, dans la cappella del Presepe. Ces fragments sont cinq petites planches minces, d’un bois noirci par le temps, dont les plus longues ont environ vingt-cinq centimètres de longueur. Elles sont liées ensemble et placées dans deux belles coquilles en cristal simulant un berceau.
À l’est de Bethléem s’étend une petite vallée, nommée Ouadi el-Scharâbéh, qui se dirige vers la mer Morte. Elle a une lieue de longueur environ et est très fertile. C’est là que s’élevait la Tour du Troupeau, Migdal Heder (Gen. XXXV, 21) auprès de laquelle Jacob fit paitre ses brebis, et où, dit S. Jérôme, veillaient, à environ mille pas de Bethléem, les bergers qui entendirent le Gloria in excélsis au moment de la Nativité (Luc. II, 14). Sainte Hélène fit construire en ce lieu une église dédiée aux saints Anges. On n’y voit plus qu’une grotte formant une chapelle souterraine où l’on descend par vingt-une marches ; on y remarque les restes d’un pavé en mosaïque, des peintures sur bois et des débris de colonnes ; elle est située au milieu d’une plantation d’oliviers entourée d’une clôture. Dans le voisinage est un champ appelé le champ de Booz (Ruth. II-III). À dix minutes de la grotte est le village de Deir er-Raouat ou Couvent des pasteurs. On croit que c’est de là qu’étaient les bergers à qui les anges annoncèrent la naissance du Sauveur. Le village d’où ils étaient porte aujourd’hui le nom de Beit-Sahour ; il est situé à quinze minutes vers l’est-sud au-dessous de Bethléem, sur une colline assez basse qui s’étend de l’ouest à l’est. On y remarque d’anciennes cavernes qui servent encore maintenant d’habitation à quelques familles ou d’abris à quelques troupeaux.
Les coutumes et les mœurs antiques se sont conservées jusqu’à présent à Bethléem. « Le costume des Bethléhémites, s’il faut en croire l’opinion commune, dit le P. de Géramb, est à peu près ce qu’il était au temps de Notre Seigneur Jésus-Christ. Celui des femmes, soit à la ville, soit aux environs, m’a particulièrement frappé. Elles sont habillées absolument comme la sainte Vierge, dans les tableaux qui la représentent ; ce sont, non seulement les mêmes formes de vêtements, mais les mêmes couleurs : robe bleue, manteau rouge, ou robe rouge, manteau bleu, et un voile blanc pardessus. La première fois qu’il m’arriva d’apercevoir de loin une Bethléhémite portant dans ses bras un petit enfant, je ne pus m’empêcher de tressaillir : il me semblait voir venir à moi Marie et l’enfant Jésus. — Une autre fois, mon émotion ne fut pas moins vive : je voyais un vieillard à cheveux blancs et barbe blanche, conduisant un âne le long de la montagne sur laquelle Bethléem est située ; il était suivi d’une jeune femme habillée de bleu et de rouge, et parée d’un voile blanc. J’étais à Bethléem ; je me crus au temps de César-Auguste. Un instant, les deux personnages furent pour moi Joseph et Marie, venant, pour obéir aux ordres du prince, se faire enregistrer. — Le costume des paysans reporte aussi la pensée vers des souvenirs touchants : il est, assure-t-on, tout à fait semblable à celui des bergers du temps de la naissance du Sauveur, et date de plus de deux mille ans. C’est une espèce de chemise ou tunique serrée autour du corps par une courroie, et un manteau par-dessus. Point de chaussure : on va ordinairement pieds nus. »
S. Matthieu rapporte que des mages vinrent à Bethléem pour adorer Jésus-Christ, et qu’ils y furent conduits par une étoile qui allait devant eux et qui s’arrêta à l’endroit où était l’enfant. Or, disent les adversaires de nos divines Écritures, personne n’ignore que les étoiles, à raison de leur immense élévation, ne peuvent indiquer une ville, pas même un pays, bien moins encore une maison.
La difficulté des incrédules tombe d’elle-même, dès que l’on considère que le terme aster employé dans le texte grec, et le mot latin Stella de la Vulgate, sont susceptibles non seulement du sens d’étoile proprement dite, mais encore d’un simple météore lumineux qui, vu à une certaine distance, a toutes les apparences d’une étoile… Le mot grec aster se trouve employé par Homère dans le sens d’un météore, auquel il compare la descente de Minerve sur la terre. Aristote s’en est également servi avec la même signification… « Nous pouvons même, sans sortir de notre langue, dit Bullet, donner un exemple de cette double acception. On appelle parmi nous étoile un météore qui parait souvent en été en forme d’une étoile qui tombe (étoile filante), et ce n’est pas seulement le peuple qui parle ainsi ; nos philosophes, qui se piquent d’une grande exactitude dans leurs expressions, ne s’expliquent point autrement. Les Arabes appellent aussi étoiles ces météores lumineux qui semblent tomber du ciel. » (J.-B. Glaire.)
La Galilée, « cercle, circuit », qui joue un si grand rôle dans l’histoire évangélique, est à peine mentionnée dans l’Ancien Testament. On l’appelait « la Galilée (ou le cercle, l’habitation) des Gentils » (Matth. IV, 15), parce que les Gentils ou païens y habitaient en grand nombre. À l’époque des Macchabées, ils y étaient plus nombreux que les Juifs eux-mêmes. Ils venaient principalement de la Phénicie et étaient attirés par la richesse de cette fertile contrée.
Au commencement, on ne donnait le nom de Galilée qu’à la partie haute du pays, qui s’étend vers l’ouest au nord du lac de Tibériade, et qui était occupée par les tribus d’Aser, de Zabulon et d’Issachar (d’où l’application de la prophétie d’Isaïe faite par S. Matthieu, IV, 14-16). Après la captivité, les Juifs reprirent peu à peu possession du pays, en s’établissant d’abord au sud, mais la population fut toujours une population mixte.
Du temps de Jésus-Christ, la Galilée formait une province particulière et se divisait en Galilée supérieure et en Galilée inférieure. Josèphe nous a laissé une description des deux Galilée : « Au couchant, dit-il, elles ont pour limites les frontières du territoire de Ptolémaïs et le Carmel, montagne appartenant autrefois aux Galiléens et maintenant aux Tyriens ; au midi, la Samarie et Scythopolis (voir la note sur la Décapole) jusqu’aux rives du Jourdain ; au levant, l’Hippène et la Gadaritide, ainsi que la Gaulanitide et les frontières du royaume d’Agrippa ; au septentrion enfin, Tyr et toute la région des Tyriens. La Galilée inférieure se développe en longueur depuis Tibériade jusqu’à Zabulon, qu’avoisine sur la côte Ptolémaïs, et, en largeur, depuis le bourg de Xaloth, situé dans la Grande Plaine, jusqu’à Bersabée, où commence la Galilée supérieure. Celle-ci s’étend de là en largeur jusqu’à Baka, qui la sépare du pays des Tyriens, et en longueur depuis Thella, bourg voisin du Jourdain, jusqu’à Meroth. »
Les montagnes les plus hautes de la Galilée inférieure s’élèvent à peine à six cents mètres au-dessus de la Méditerranée. « Parsemées d’innombrables vallées généralement très fertiles, elles étaient elles-mêmes autrefois cultivées jusqu’à leur sommet, et sur leurs pentes s’étageaient de belles plantations d’oliviers, de figuiers, de vignes et d’autres arbres fruitiers que des broussailles ont en partie remplacées depuis longtemps ; à leur pied croissaient, comme maintenant encore, du blé, de l’orge et d’autres céréales. » (V. Guérin.)
Nazareth, dont le nom signifie vraisemblablement « rejeton », est une bourgade de Galilée qui n’est pas mentionnée une seule fois dans l’Ancien Testament. Elle doit toute sa célébrité au séjour qu’y a fait Notre Seigneur. Bâtie en étages sur un amphithéâtre entouré de toutes parts de collines, elle est à 270 mètres environ au-dessus de la plaine d’Esdrelon. C’est un des endroits les plus agréables et les plus gracieux de la Palestine. Ses maisons à toits plats et toutes en pierre, avec leurs murs d’un blanc éblouissant, sont encadrées dans la verdure. Partout des jardins, des oliviers, des figuiers et des cactus. Sur l’emplacement de la maison de la sainte Vierge s’élève aujourd’hui l’église de l’Annonciation, au sud de la ville. Cette église a été construite dans sa forme actuelle en 1730 ; elle a reçu divers embellissements en 1877. La maison qu’avait habitée la sainte Famille fut transportée miraculeusement à Lorette à la fin du XIIIe siècle. Elle était auparavant à l’endroit qui porte aujourd’hui le nom de Chapelle de l’Annonciation, dans la crypte de l’église du même nom. « Cette chapelle est divisée par un mur en deux parties. La première partie contient l’autel de l’Annonciation. En face de l’autel, à gauche, on voit deux colonnes en granit qui marquent, selon la tradition, la place où se tenaient l’ange Gabriel et Marie à l’heure de l’Annonciation. L’autel, fort simple, orné seulement d’un tableau moderne représentant l’Annonciation, est entouré de lampes d’argent, et sur la table de granit qui forme la paroi du fond, on lit ces mots : Verbum caro hic factum est, à droite de l’autel, une petite porte conduit dans une arrière-salle (chapelle de S. Joseph), où l’on trouve un autre autel adossé au précédent, et orné d’un tableau représentant la Fuite en Égypte. (Sur l’autel on lit cette inscription : hic erat súbditus illis.) De là un escalier de quelques marches monte dans une petite chambre taillée dans le roc, qui représente la cuisine de la sainte Vierge. » (Isambert.)
Au nord-est de l’église de l’Annonciation, dans le quartier musulman actuel, est situé l’Atelier de S. Joseph. On croit qu’une église avait été construite sur cet emplacement par les Croisés. Il n’en reste que quelques débris, sur une partie desquels les Franciscains ont élevé une chapelle de 1858 à 1859. Il est impossible de savoir au juste comment était disposé ce lieu du temps de Notre Seigneur.
À quatre minutes de Nazareth, au nord-est, est la Fontaine de la Vierge, dont la source est enfermée aujourd’hui dans la partie septentrionale de l’église de S. Gabriel qui appartient aux Grecs. L’eau passe dans un canal devant l’autel de l’église, à gauche, et est ainsi conduite à la Fontaine proprement dite, où l’on voit toujours des femmes qui viennent y remplir de grandes urnes à forme antique. Cette eau est bonne et abondante et sert à arroser les jardins de Nazareth en même temps qu’elle abreuve ses habitants. Comme c’est l’unique fontaine qu’on rencontre dans toute la localité, on ne saurait douter que la sainte Vierge et l’enfant Jésus ne s’y soient rendus souvent
Les Pharisiens ne passaient pas pour alléger le joug de la loi. En général, leur doctrine était exacte. Cependant Notre Seigneur leur reproche de s’écarter, sur des points importants, de la justice et de la vérité : « Ce sont des aveugles, dit-il, et des conducteurs d’aveugles. » Tandis qu’ils poussaient jusqu’au scrupule l’exactitude aux petites choses, ils se mettaient peu en peine du grand précepte de la charité. Ils disaient : « Œil pour œil et dent pour dent, » ce que S. Augustin appelle justítia injustórum. Ils comptaient pour peu de chose les fautes intérieures. Ils éludaient certaines obligations par des subtilités. Ils en exagéraient d’autres au-delà de toute mesure, surtout la loi du sabbat.
Leur caractère était bien plus répréhensible que leur enseignement. Sauf un petit nombre, dont la vertu contrastait avec les défauts de la secte, entre autres Nicodème, neveu de Gamaliel, ils étaient orgueilleux, fiers de leur savoir, pleins de prétention, de dédain pour leurs frères, insensibles aux faiblesses et aux besoins du prochain, avares, hypocrites. Ils disaient et ne faisaient point. Ils affectaient l’austérité, le jeûne, les ablutions fréquentes, les longues prières ; mais tout cela par amour-propre et par intérêt. Il leur fallait partout les premières places et les témoignages de respect. Ils rendaient eux-mêmes des honneurs aux prophètes, quand ils étaient morts ; mais durant leur vie, quand ceux-ci les reprenaient de leurs vices, ils les persécutaient et cherchaient à les perdre. Ils passaient les mers et parcouraient le monde pour faire des prosélytes, mais dans la seule vue de les attacher à leur secte et de leur inoculer leurs principes et leurs vices. En somme, Notre Seigneur leur préférait les publicains, quoique odieux au peuple et regardés, dit Tertullien comme des pécheurs de profession. Aussi les frappe-t-il, peu de temps avant sa mort des plus terribles malédictions. De leur côté, les pharisiens ne pouvaient le souffrir. Ils étaient jaloux de sa réputation, de son influence et de ses miracles. Après lui avoir tendu toutes sortes de pièges et lui avoir suscité toutes sortes d’opposition, ils finirent par le faire attacher à la croix. (L. Bacuez.)
L’origine du nom des Sadducéens est douteuse. D’après la tradition commune des Juifs, les Sadducéens étaient ainsi appelés de Sadoc, disciple d’Antigone de Socho, lequel avait reçu la loi orale de la bouche de Simon le Juste, le dernier membre de la Grande Synagogue. Quoi qu’il en soit, du temps de Notre Seigneur, la secte des Sadducéens se composait surtout des membres de l’aristocratie juive. Sur la plupart des points, ils étaient en opposition avec les Pharisiens. Ceux-ci affirmaient que Moïse, outre la loi écrite, avait donné aux Israélites une loi orale, qui s’était conservée par tradition. Les Sadducéens le niaient. Leur principale erreur, qui leur est reprochée expressément dans l’Évangile, consistait à rejeter le dogme de la résurrection des morts. Ils n’admettaient pas non plus l’existence des anges. Les Sadducéens disparaissent de l’histoire avec le premier siècle et cèdent la place aux Pharisiens dont les croyances deviennent bientôt tout à fait prédominantes parmi les Juifs.
« Ce lac, auquel les Hébreux donnaient aussi le nom de mer, comme à tous les amas d’eau un peu considérable, s’appela d’abord lac de Cenereth, de Génésareth ou de Génésar : dénominations qui, bien que diverses, ne désignaient qu’une seule et même ville, un seul et même pays à l’extrémité méridionale de la Galilée. On le nommait encore mer de Galilée, parce que vers le nord et l’orient il était enveloppé de cette province. Il ne prit le nom de Tibériade que lorsqu’Hérode eut fait bâtir cette ville, sur l’emplacement, dit-on, de Génésareth, en l’honneur de Tibère, lors de l’élévation de ce prince à l’empire. — Quoique dépouillé des villes, des villages et des magnifiques maisons qui l’embellissaient il y a deux mille ans, et malgré la nudité des montagnes qui l’entourent, ce lac n’en offre pas moins encore aujourd’hui un aspect délicieux. Bordé de tous côtés de lauriers-roses, qui inclinent leurs branches touffues et fleuries sur la tranquille surface de ses ondes limpides, il présente l’image charmante d’un immense miroir encadré dans une guirlande de verdure et de fleurs. C’est une miniature du lac de Genève. » (De Géramb.)
Tous ceux qui l’ont visité ont été ravis d’admiration par sa beauté. « La mer de Galilée, large d’environ une lieue à l’extrémité méridionale, s’élargit insensiblement, dit Lamartine, les montagnes qui la resserrent [au sud] s’ouvrent en larges golfes des deux côtés, et lui forment un vaste bassin [ovale], où elle s’étend et se développe dans un lit d’environ quinze à douze lieues de tour. Ce bassin n’est pas régulier dans sa forme, les montagnes ne descendent pas partout jusqu’à ses ondes : tantôt elles s’écartent à quelque distance du rivage et laissent entre elles et cette mer une petite plaine basse, fertile et verte comme la plaine de Génésareth ; tantôt elles se séparent et s’entrouvrent pour laisser pénétrer ses flots bleus dans des golfes creusés à leur pied et ombragés de leur ombre.
La main du peintre le plus suave ne dessinerait pas des contours plus arrondis, plus indécis et plus variés que ceux que la main créatrice a donnés à ces eaux et à ces montagnes ; elle semble avoir préparé la scène évangélique pour l’œuvre de grâce, de paix, de réconciliation et d’amour qui devait une fois s’y accomplir. À l’orient, les montagnes forment, depuis les cimes du Gelboé, qu’on entrevoit du côté du midi, jusqu’aux cimes du Liban, qui se montrent au nord, une chaine serrée, mais ondulée et flexible, dont les sombres anneaux semblent de temps en temps prêts à se détendre et se brisent même çà et là pour laisser passer un peu de ciel.
Au bout du lac, vers le nord, cette chaine de montagnes s’abaisse en s’éloignant ; on distingue de loin une plaine qui vient mourir dans les flots, et, à l’extrémité de cette plaine, une masse blanche d’écume qui semble rouler d’assez haut dans la mer. C’est le Jourdain qui se précipite de là dans le lac. Toute cette extrémité nord de la mer de Galilée est bordée d’une lisière de champs qui paraissent cultivés.
Les bords de la mer de Galilée, de ce côté de la Judée, n’étaient, pour ainsi dire, qu’une seule ville. Les débris multipliés devant nous et la multitude des villes et la magnificence des constructions que leurs fragments mutilés témoignent, rappellent à ma mémoire la route qui longe le pied du Vésuve, de Castellamare à Portici. Comme là, les bords du lac de Génésareth semblaient porter des villes au lieu de moissons et de forêts. » (Lamartine.)
[Le passage entre crochet est corrigé, PPII, 2012]
Matt, XII, 46, ses frères, c’est-à-dire ses cousins ou ses proches en général. Chez les Hébreux, comme chez les autres peuples de l’antiquité, le mot frère se prenait souvent dans ce sens plus étendu. Ainsi dans la Gen. XIII, 8, Abraham et Lot sont appelés frères ; cependant Lot n’était que le neveu d’Abraham, puisque celui-ci était frère d’Aran, le père de Lot (Gen. XI, 27). [En Gen. XXIV, 47, Bathuel est dit frère d’Abraham ; mais ce même Bathuel était fils de Nachor, le propre frère d’Abraham, et, par conséquent, son neveu. De même dans la Gen. XXIX, 15, Jacob est dit frère de Laban, alors qu’il est le fils de sa sœur Rébecca.]
Dans le livre de Tob. VII, 4, Ragouël donne le nom de frère à Tobie, son véritable cousin (vers. 2). Dans le même livre, VIII, 9, le jeune Tobie, parlant à la fille de Ragouël, qui était simplement sa cousine, lui dit : Ma sœur. On peut voir d’autres exemples dans le Lev. XXV, 48 ; Deut. II, 4, 8, etc. Pour n’en citer qu’un seul pris d’un autre peuple, nous ferons remarquer que, dans Quinte-Curce, Amyntas est appelé frère d’Alexandre, bien qu’il ne fut que son cousin germain, du côté de son père. Ainsi l’Évangile a pu donner le nom de frères et de sœurs de Jésus à des personnes qui étaient simplement ses proches ; mais l’a-t-il donné réellement ? Il nous semble qu’il n’y a pas lieu d’en douter. — Toute l’antiquité chrétienne, comme le remarque justement D. Calmet, a toujours cru que Marie avait conservé sa virginité après, comme avant et pendant l’enfantement miraculeux de son divin fils Jésus. Quant à l’objection de quelques anciens hérétiques, tels qu’Eunómius et Helvídius, prédécesseurs des protestants et des rationalistes modernes, nous y avons suffisamment répondu (page --[2]), par des arguments qu’une saine critique ne saurait légitimement récuser. Toutefois nous croyons devoir en ajouter ici un nouveau en faveur de ceux de nos lecteurs qui ne sont pas étrangers à la philologie sacrée. Il est certain que le terme hébreu becôr, rendu dans le texte grec par prôtotokos, et, dans la Vulgate, par primogénitus ou premier-né, signifie proprement, comme phéter réhem (ou simplement phéter), qui lui sert souvent d’explicatif, fente, ouverture, et ce qui fend, ce qui ouvre un sein (quod áperit vulvam). Or il n’y a rien là qui prouve que la très sainte Vierge ait eu d’autres enfants après Jésus-Christ. — Nous ajouterons, avec Aberle (Dict. de la Théol. cathol.),que si ces frères de Jésus-Christ, dont parle l’Évangile, avaient été ses véritables frères selon la chair, il serait très singulier que jamais Marie n’eût été appelée leur mère ; il serait tout à fait inconcevable que Jésus eût recommandé sur la croix sa mère à saint Jean (Joan. XIX, 26, 27), tandis qu’ayant d’autres fils, c’eût été le devoir naturel de ceux-ci de la recueillir, et ils n’y auraient certainement pas manqué. — On ne voit dans le Nouveau Testament, comme fils de Marie, que Jésus, et c’est précisément par opposition avec ceux qui sont appelés ses frères, qu’il est désigné comme le fils de Marie (Marc. VI, 3). — La manière dont Jésus, du haut de la croix, recommande sa mère à saint Jean prouve encore qu’il était le fils unique de Marie, car il est dit littéralement : Voilà le fils de vous ; avec l’article déterminatif, qui aurait évidemment manqué, s’il y avait encore d’autres fils de Marie. — Un nouvel argument en faveur de notre thèse est la possibilité de démontrer quelle fut, en dehors de la très sainte Vierge, la véritable mère de ceux qui sont appelés les frères du Sauveur. Saint Matthieu cite (XXVII, 56), parmi les femmes présentes au crucifiement, une Marie, mère de Jacques et de Joseph ; saint Marc le dit également (XV, 40), et, de plus, il distingue ce Jacques d’un autre Jacques, fils de Zébédée, par le surnom de le petit (o mikros) ou le mineur. Comme il ne parait en général dans le Nouveau Testament que deux Jacques, il n’y a pas de doute que le premier ne soit celui que saint Paul nomme (Gal. I, 19) le frère du Seigneur, celui à qui sa position comme premier évêque de Jérusalem, donnait alors une haute importance ; celui enfin dont l’épître fait partie du Nouveau Testament. — Saint Jude, au commencement de son épître, se nomme frère de ce Jacques. Ainsi on trouve dans le Nouveau Testament pour trois des frères du Seigneur, Jacques, Joseph et Jude, une Marie qui est leur mère, et qui est différente de la mère de Jésus. Or, cette Marie est, sans aucun doute, identique avec la Marie nommée par saint Jean (XIX, 25) la femme de Cléophas et la sœur de la mère du Seigneur. Cléophas, ou selon une autre forme de ce même nom, Alphée, était par conséquent le père de Jacques, de Joseph et de Jude ; et, en effet, Jacques est, en plusieurs circonstances (Matth. X, 3 ; Marc. III, 18 ; Luc. VI, 15 ; Act. I, 13), nommé le fils d’Alphée. Pour Simon ou Siméon, il est expressément désigné comme le fils de Cléophas par Hégésippe, le plus ancien historien de l’Église. Il est donc incontestable que les quatre frères de Jésus étaient simplement ses cousins du côté de sa mère ; et si, d’après la donnée d’Hégésippe, Cléophas était un frère de saint Joseph, ils l’étaient aussi vraisemblablement du côté paternel. — On a objecté que deux sœurs vivantes n’ont pas pu porter le même nom. Mais il fallait prouver que cela n’avait jamais lieu chez les Juifs, surtout dans les derniers temps. Cet usage existait incontestablement chez les Latins, puisque, sur les quatre filles qu’avait Octavie, la sœur de l’empereur Auguste, et qui vécurent en même temps, deux se nommaient, sans autre surnom, Marcella, et les deux autres Octavie. — On a dit encore que, d’après saint Hilaire, saint Épiphane, Théophylacte et plusieurs autres anciens, saint Joseph avait eu des enfants d’une autre femme avant son mariage avec la sainte Vierge, et que ce sont ces enfants que l’Écriture appelle les frères de Jésus-Christ. Origène remarque à ce sujet que c’est le faux évangile de saint Pierre ou celui de saint Jacques qui a donné lieu à cette opinion. Il est certain qu’elle n’est nullement fondée sur la tradition, et il est très vraisemblable que ceux qui l’ont adoptée l’ont fait uniquement parce qu’ils ont cru devoir prendre ici le mot frère dans sa signification propre, en l’étendant seulement aux frères de lits différents. Les interprètes ont donc pu avec raison dresser le tableau généalogique suivant, lequel montre que les prétendus frères de Jésus n’étaient que ses cousins.
Nos adversaires, nous ne l’ignorons pas, ont opposé à nos arguments des difficultés plus ou moins spécieuses ; mais ils sont forcés de convenir que ces difficultés ne dépassent pas les limites de l’hypothèse, et que sous ce rapport même notre sentiment est le mieux fondé en raisons. Quoi qu’il en soit, nous avons pour nous toute l’antiquité chrétienne, qui a toujours cru que Marie avait conservé sa virginité après avoir enfanté Jésus-Christ. Or, un pareil témoignage, si on consulte la vraie critique, doit l’emporter sur toutes les hypothèses, même les plus séduisantes. (J.-B. Glaire.)
« La beauté et le charme, même littéraire, des paraboles de l’Évangile m’ont attiré… La parabole évangélique est un petit drame, et je n’Hésite pas à dire qu’à considérer la vérité des caractères et de l’action, ces drames sont plus vivants et plus animés que les apologues les plus admirés. Ils représentent la vie du monde et de la terre aussi bien que s’ils n’étaient pas destinés à nous enseigner la vie du ciel… Les caractères que j’admire dans les paraboles évangéliques [sont] la variété des détails, la vivacité de l’action, et, de plus, l’élévation et la pureté de la morale ; c’est là ce qui fait la divine supériorité de la parabole évangélique sur l’apologue oriental… La leçon que donne la fable est d’une morale médiocre et toute mondaine : la leçon évangélique indique à l’homme la voie à suivre pour arriver au ciel. La parabole a toutes les formes et tous les agréments de la fable ; elle a de plus une morale toute divine… Nulle part ce caractère de la parabole, égale à l’apologue pour la forme, supérieure pour la morale, n’éclate mieux que dans les grandes paraboles de l’enfant prodigue ou du mauvais riche. L’enfant prodigue est passé en tradition dans la littérature ; le mauvais riche est entré dans la peinture, dont il est devenu un des sujets favoris… L’action est vive et frappante ; elle grave profondément dans l’esprit la morale qu’elle contient ; c’est un drame que personne n’oublie une fois qu’il l’a vu et qui rappelle à chacun de nous la leçon qu’il exprime… Il y a dans les auteurs anciens bien des récits allégoriques destinés à exprimer des vérités morales ou métaphysiques. La Grèce aimait ces mythes, à ce point même qu’elle en oubliait le sens pour la forme ; Platon se servait souvent de ces fables symboliques ; mais il n’y a aucun de ces récits mythologiques qui, même dans Platon, puissent être comparés aux paraboles évangéliques. Ils n’ont ni la simplicité ravissante, ni la vérité expressive, ni l’utilité et la clarté morale de la parabole. » (Saint-Marc Girardin.)
²
£